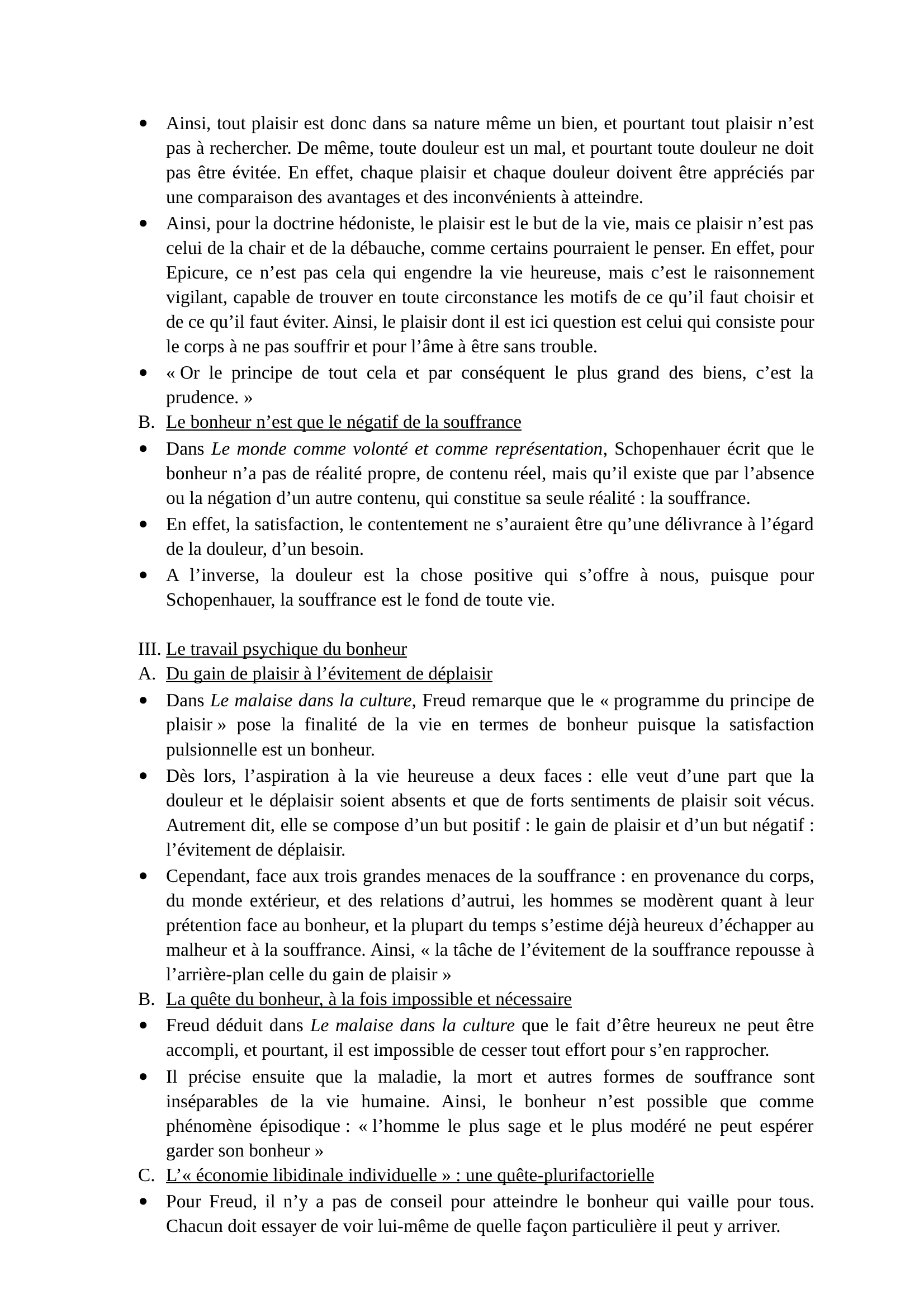Le bonheur
Publié le 06/02/2013

Extrait du document
«
· Ainsi, tout plaisir est donc dans sa nature même un bien, et pourtant tout plaisir n’est
pas à rechercher.
De même, toute douleur est un mal, et pourtant toute douleur ne doit
pas être évitée.
En effet, chaque plaisir et chaque douleur doivent être appréciés par
une comparaison des avantages et des inconvénients à atteindre.
· Ainsi, pour la doctrine hédoniste, le plaisir est le but de la vie, mais ce plaisir n’est pas
celui de la chair et de la débauche, comme certains pourraient le penser.
En effet, pour
Epicure, ce n’est pas cela qui engendre la vie heureuse, mais c’est le raisonnement
vigilant, capable de trouver en toute circonstance les motifs de ce qu’il faut choisir et
de ce qu’il faut éviter.
Ainsi, le plaisir dont il est ici question est celui qui consiste pour
le corps à ne pas souffrir et pour l’âme à être sans trouble.
· « Or le principe de tout cela et par conséquent le plus grand des biens, c’est la
prudence.
»
B.
Le bonheur n’est que le négatif de la souffrance
· Dans Le monde comme volonté et comme représentation , Schopenhauer écrit que le
bonheur n’a pas de réalité propre, de contenu réel, mais qu’il existe que par l’absence
ou la négation d’un autre contenu, qui constitue sa seule réalité : la souffrance.
· En effet, la satisfaction, le contentement ne s’auraient être qu’une délivrance à l’égard
de la douleur, d’un besoin.
· A l’inverse, la douleur est la chose positive qui s’offre à nous, puisque pour
Schopenhauer, la souffrance est le fond de toute vie.
III.
Le travail psychique du bonheur
A.
Du gain de plaisir à l’évitement de déplaisir
· Dans Le malaise dans la culture , Freud remarque que le « programme du principe de
plaisir » pose la finalité de la vie en termes de bonheur puisque la satisfaction
pulsionnelle est un bonheur.
· Dès lors, l’aspiration à la vie heureuse a deux faces : elle veut d’une part que la
douleur et le déplaisir soient absents et que de forts sentiments de plaisir soit vécus.
Autrement dit, elle se compose d’un but positif : le gain de plaisir et d’un but négatif :
l’évitement de déplaisir.
· Cependant, face aux trois grandes menaces de la souffrance : en provenance du corps,
du monde extérieur, et des relations d’autrui, les hommes se modèrent quant à leur
prétention face au bonheur, et la plupart du temps s’estime déjà heureux d’échapper au
malheur et à la souffrance.
Ainsi, « la tâche de l’évitement de la souffrance repousse à
l’arrière-plan celle du gain de plaisir »
B.
La quête du bonheur, à la fois impossible et nécessaire
· Freud déduit dans Le malaise dans la culture que le fait d’être heureux ne peut être
accompli, et pourtant, il est impossible de cesser tout effort pour s’en rapprocher.
· Il précise ensuite que la maladie, la mort et autres formes de souffrance sont
inséparables de la vie humaine.
Ainsi, le bonheur n’est possible que comme
phénomène épisodique : « l’homme le plus sage et le plus modéré ne peut espérer
garder son bonheur »
C.
L’« économie libidinale individuelle » : une quête-plurifactorielle
· Pour Freud, il n’y a pas de conseil pour atteindre le bonheur qui vaille pour tous.
Chacun doit essayer de voir lui-même de quelle façon particulière il peut y arriver..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- AU BONHEUR DES DAMES
- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames
- sujet de réflexion au bonheur des dames
- DISSERTATION : AU BONHEUR DES DAMES: Comment Zola applique-t-il le naturalisme dans une œuvre romanesque ?
- Le bonheur(notes de cours)