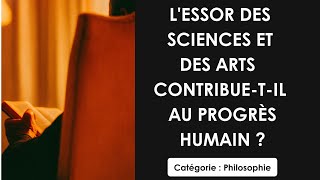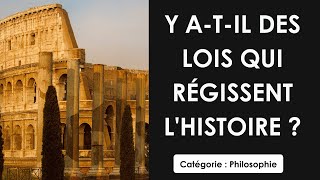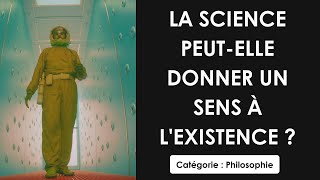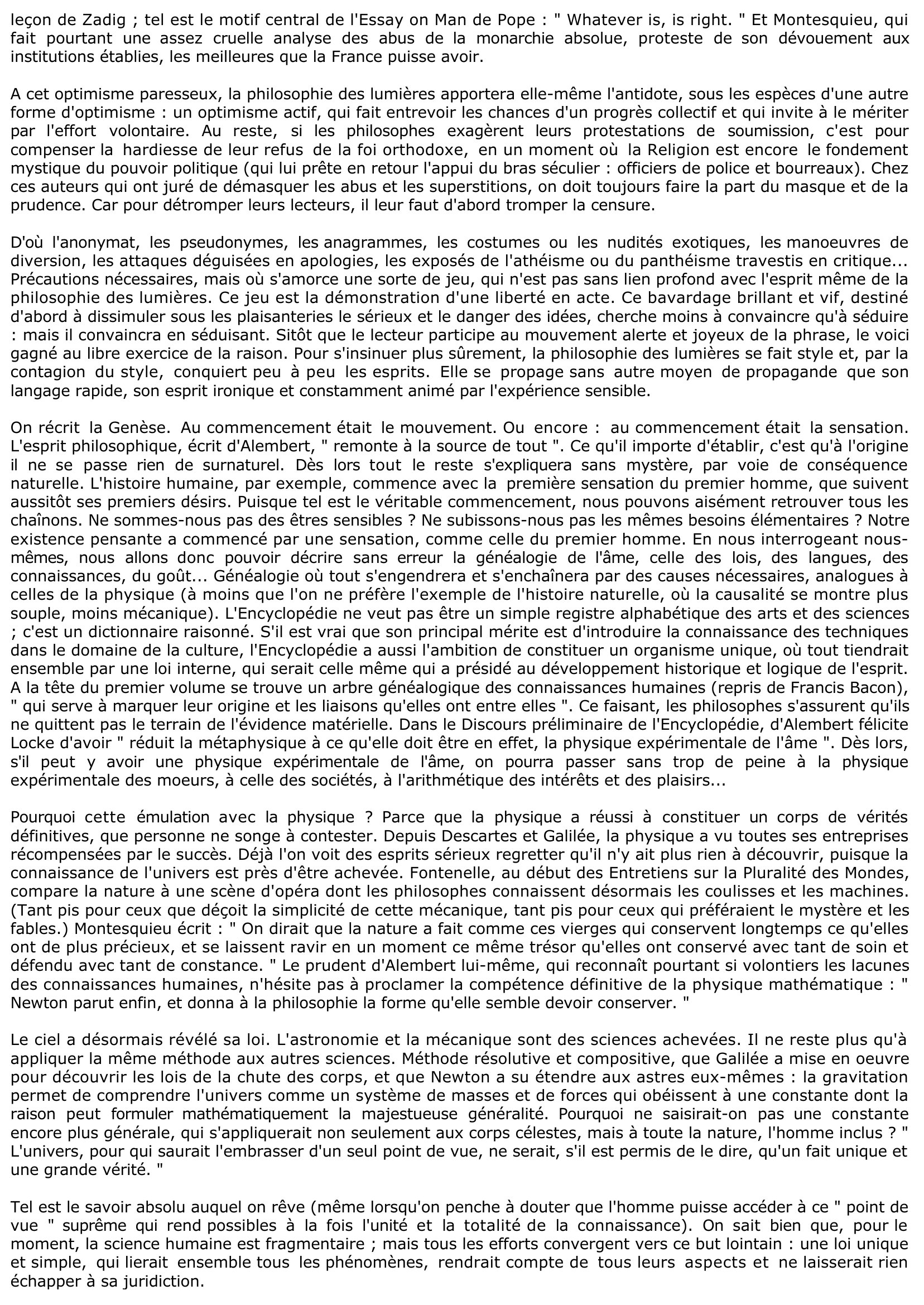Le rationalisme du XVIIIe siècle
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
leçon de Zadig ; tel est le motif central de l'Essay on Man de Pope : " Whatever is, is right.
" Et Montesquieu, quifait pourtant une assez cruelle analyse des abus de la monarchie absolue, proteste de son dévouement auxinstitutions établies, les meilleures que la France puisse avoir.
A cet optimisme paresseux, la philosophie des lumières apportera elle-même l'antidote, sous les espèces d'une autreforme d'optimisme : un optimisme actif, qui fait entrevoir les chances d'un progrès collectif et qui invite à le mériterpar l'effort volontaire.
Au reste, si les philosophes exagèrent leurs protestations de soumission, c'est pourcompenser la hardiesse de leur refus de la foi orthodoxe, en un moment où la Religion est encore le fondementmystique du pouvoir politique (qui lui prête en retour l'appui du bras séculier : officiers de police et bourreaux).
Chezces auteurs qui ont juré de démasquer les abus et les superstitions, on doit toujours faire la part du masque et de laprudence.
Car pour détromper leurs lecteurs, il leur faut d'abord tromper la censure.
D'où l'anonymat, les pseudonymes, les anagrammes, les costumes ou les nudités exotiques, les manoeuvres dediversion, les attaques déguisées en apologies, les exposés de l'athéisme ou du panthéisme travestis en critique...Précautions nécessaires, mais où s'amorce une sorte de jeu, qui n'est pas sans lien profond avec l'esprit même de laphilosophie des lumières.
Ce jeu est la démonstration d'une liberté en acte.
Ce bavardage brillant et vif, destinéd'abord à dissimuler sous les plaisanteries le sérieux et le danger des idées, cherche moins à convaincre qu'à séduire: mais il convaincra en séduisant.
Sitôt que le lecteur participe au mouvement alerte et joyeux de la phrase, le voicigagné au libre exercice de la raison.
Pour s'insinuer plus sûrement, la philosophie des lumières se fait style et, par lacontagion du style, conquiert peu à peu les esprits.
Elle se propage sans autre moyen de propagande que sonlangage rapide, son esprit ironique et constamment animé par l'expérience sensible.
On récrit la Genèse.
Au commencement était le mouvement.
Ou encore : au commencement était la sensation.L'esprit philosophique, écrit d'Alembert, " remonte à la source de tout ".
Ce qu'il importe d'établir, c'est qu'à l'origineil ne se passe rien de surnaturel.
Dès lors tout le reste s'expliquera sans mystère, par voie de conséquencenaturelle.
L'histoire humaine, par exemple, commence avec la première sensation du premier homme, que suiventaussitôt ses premiers désirs.
Puisque tel est le véritable commencement, nous pouvons aisément retrouver tous leschaînons.
Ne sommes-nous pas des êtres sensibles ? Ne subissons-nous pas les mêmes besoins élémentaires ? Notreexistence pensante a commencé par une sensation, comme celle du premier homme.
En nous interrogeant nous-mêmes, nous allons donc pouvoir décrire sans erreur la généalogie de l'âme, celle des lois, des langues, desconnaissances, du goût...
Généalogie où tout s'engendrera et s'enchaînera par des causes nécessaires, analogues àcelles de la physique (à moins que l'on ne préfère l'exemple de l'histoire naturelle, où la causalité se montre plussouple, moins mécanique).
L'Encyclopédie ne veut pas être un simple registre alphabétique des arts et des sciences; c'est un dictionnaire raisonné.
S'il est vrai que son principal mérite est d'introduire la connaissance des techniquesdans le domaine de la culture, l'Encyclopédie a aussi l'ambition de constituer un organisme unique, où tout tiendraitensemble par une loi interne, qui serait celle même qui a présidé au développement historique et logique de l'esprit.A la tête du premier volume se trouve un arbre généalogique des connaissances humaines (repris de Francis Bacon)," qui serve à marquer leur origine et les liaisons qu'elles ont entre elles ".
Ce faisant, les philosophes s'assurent qu'ilsne quittent pas le terrain de l'évidence matérielle.
Dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, d'Alembert féliciteLocke d'avoir " réduit la métaphysique à ce qu'elle doit être en effet, la physique expérimentale de l'âme ".
Dès lors,s'il peut y avoir une physique expérimentale de l'âme, on pourra passer sans trop de peine à la physiqueexpérimentale des moeurs, à celle des sociétés, à l'arithmétique des intérêts et des plaisirs...
Pourquoi cette émulation avec la physique ? Parce que la physique a réussi à constituer un corps de véritésdéfinitives, que personne ne songe à contester.
Depuis Descartes et Galilée, la physique a vu toutes ses entreprisesrécompensées par le succès.
Déjà l'on voit des esprits sérieux regretter qu'il n'y ait plus rien à découvrir, puisque laconnaissance de l'univers est près d'être achevée.
Fontenelle, au début des Entretiens sur la Pluralité des Mondes,compare la nature à une scène d'opéra dont les philosophes connaissent désormais les coulisses et les machines.(Tant pis pour ceux que déçoit la simplicité de cette mécanique, tant pis pour ceux qui préféraient le mystère et lesfables.) Montesquieu écrit : " On dirait que la nature a fait comme ces vierges qui conservent longtemps ce qu'ellesont de plus précieux, et se laissent ravir en un moment ce même trésor qu'elles ont conservé avec tant de soin etdéfendu avec tant de constance.
" Le prudent d'Alembert lui-même, qui reconnaît pourtant si volontiers les lacunesdes connaissances humaines, n'hésite pas à proclamer la compétence définitive de la physique mathématique : "Newton parut enfin, et donna à la philosophie la forme qu'elle semble devoir conserver.
"
Le ciel a désormais révélé sa loi.
L'astronomie et la mécanique sont des sciences achevées.
Il ne reste plus qu'àappliquer la même méthode aux autres sciences.
Méthode résolutive et compositive, que Galilée a mise en oeuvrepour découvrir les lois de la chute des corps, et que Newton a su étendre aux astres eux-mêmes : la gravitationpermet de comprendre l'univers comme un système de masses et de forces qui obéissent à une constante dont laraison peut formuler mathématiquement la majestueuse généralité.
Pourquoi ne saisirait-on pas une constanteencore plus générale, qui s'appliquerait non seulement aux corps célestes, mais à toute la nature, l'homme inclus ? "L'univers, pour qui saurait l'embrasser d'un seul point de vue, ne serait, s'il est permis de le dire, qu'un fait unique etune grande vérité.
"
Tel est le savoir absolu auquel on rêve (même lorsqu'on penche à douter que l'homme puisse accéder à ce " point devue " suprême qui rend possibles à la fois l'unité et la totalité de la connaissance).
On sait bien que, pour lemoment, la science humaine est fragmentaire ; mais tous les efforts convergent vers ce but lointain : une loi uniqueet simple, qui lierait ensemble tous les phénomènes, rendrait compte de tous leurs aspects et ne laisserait rienéchapper à sa juridiction..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le rationalisme du XVIIIe siècle par Jean Starobinski Professeur à l'Université Johns Hophins, Baltimore Ils se sont donné le nom de Philosophes.
- XVIIIe siècle: les Lumières
- INTRODUCTION AU XVIIIe siècle en philosophie
- La Place des femmes dans la famille en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle
- La modernité et l’unité par la volonté (xvie-xviiie siècle): Machiavel, Hobbes, Locke, Rousseau