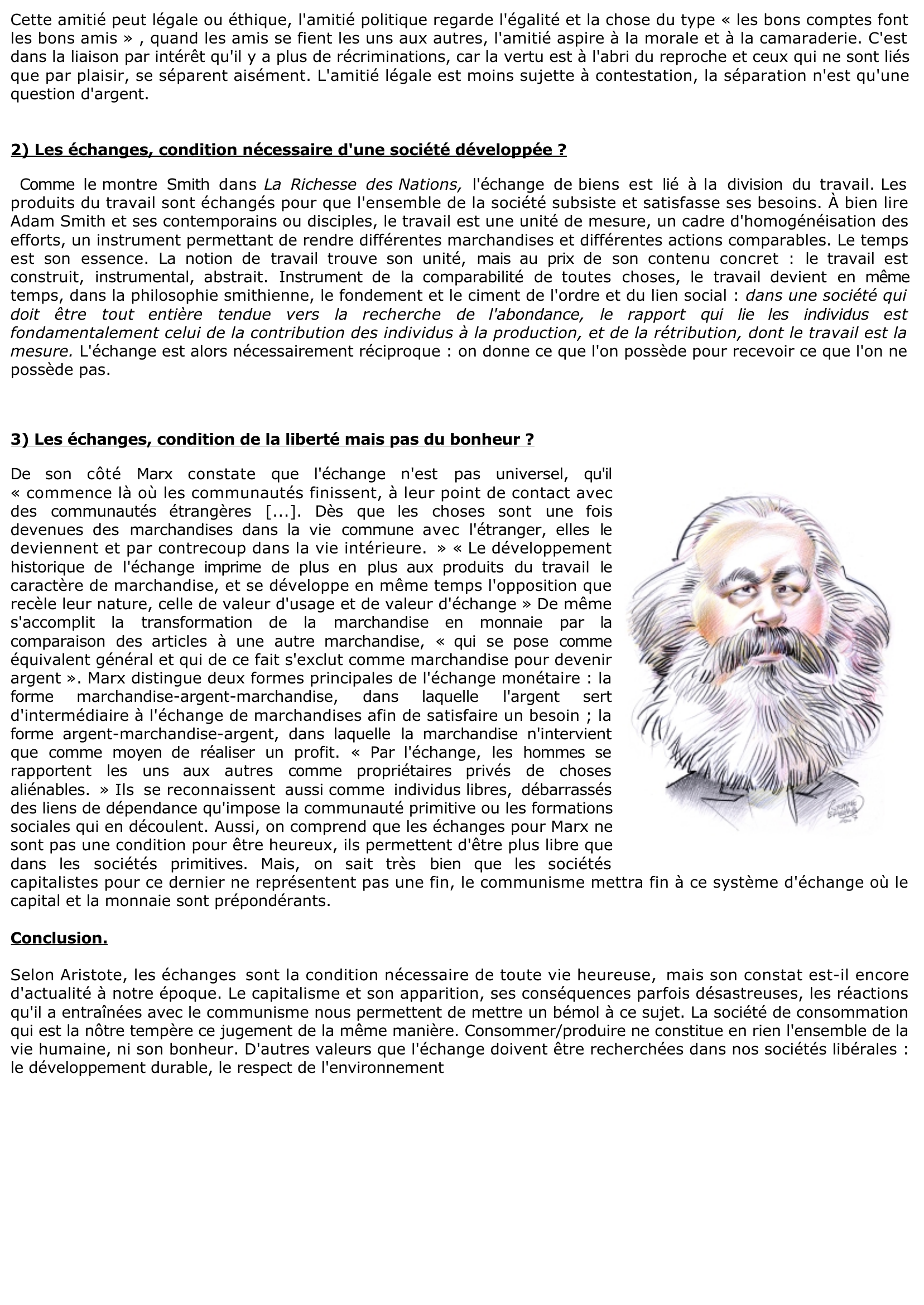Les échanges font-ils notre bonheur ?
Publié le 27/02/2008

Extrait du document
«
Cette amitié peut légale ou éthique, l'amitié politique regarde l'égalité et la chose du type « les bons comptes fontles bons amis » , quand les amis se fient les uns aux autres, l'amitié aspire à la morale et à la camaraderie.
C'estdans la liaison par intérêt qu'il y a plus de récriminations, car la vertu est à l'abri du reproche et ceux qui ne sont liésque par plaisir, se séparent aisément.
L'amitié légale est moins sujette à contestation, la séparation n'est qu'unequestion d'argent.
2) Les échanges, condition nécessaire d'une société développée ?
Comme le montre Smith dans La Richesse des Nations, l'échange de biens est lié à la division du travail.
Les produits du travail sont échangés pour que l'ensemble de la société subsiste et satisfasse ses besoins.
À bien lireAdam Smith et ses contemporains ou disciples, le travail est une unité de mesure, un cadre d'homogénéisation desefforts, un instrument permettant de rendre différentes marchandises et différentes actions comparables.
Le tempsest son essence.
La notion de travail trouve son unité, mais au prix de son contenu concret : le travail estconstruit, instrumental, abstrait.
Instrument de la comparabilité de toutes choses, le travail devient en mêmetemps, dans la philosophie smithienne, le fondement et le ciment de l'ordre et du lien social : dans une société qui doit être tout entière tendue vers la recherche de l'abondance, le rapport qui lie les individus estfondamentalement celui de la contribution des individus à la production, et de la rétribution, dont le travail est lamesure. L'échange est alors nécessairement réciproque : on donne ce que l'on possède pour recevoir ce que l'on ne possède pas.
3) Les échanges, condition de la liberté mais pas du bonheur ?
De son côté Marx constate que l'échange n'est pas universel, qu'il« commence là où les communautés finissent, à leur point de contact avecdes communautés étrangères [...].
Dès que les choses sont une foisdevenues des marchandises dans la vie commune avec l'étranger, elles ledeviennent et par contrecoup dans la vie intérieure.
» « Le développementhistorique de l'échange imprime de plus en plus aux produits du travail lecaractère de marchandise, et se développe en même temps l'opposition querecèle leur nature, celle de valeur d'usage et de valeur d'échange » De mêmes'accomplit la transformation de la marchandise en monnaie par lacomparaison des articles à une autre marchandise, « qui se pose commeéquivalent général et qui de ce fait s'exclut comme marchandise pour devenirargent ».
Marx distingue deux formes principales de l'échange monétaire : laforme marchandise-argent-marchandise, dans laquelle l'argent sertd'intermédiaire à l'échange de marchandises afin de satisfaire un besoin ; laforme argent-marchandise-argent, dans laquelle la marchandise n'intervientque comme moyen de réaliser un profit.
« Par l'échange, les hommes serapportent les uns aux autres comme propriétaires privés de chosesaliénables.
» Ils se reconnaissent aussi comme individus libres, débarrassésdes liens de dépendance qu'impose la communauté primitive ou les formationssociales qui en découlent.
Aussi, on comprend que les échanges pour Marx nesont pas une condition pour être heureux, ils permettent d'être plus libre quedans les sociétés primitives.
Mais, on sait très bien que les sociétéscapitalistes pour ce dernier ne représentent pas une fin, le communisme mettra fin à ce système d'échange où lecapital et la monnaie sont prépondérants.
Conclusion.
Selon Aristote, les échanges sont la condition nécessaire de toute vie heureuse, mais son constat est-il encored'actualité à notre époque.
Le capitalisme et son apparition, ses conséquences parfois désastreuses, les réactionsqu'il a entraînées avec le communisme nous permettent de mettre un bémol à ce sujet.
La société de consommationqui est la nôtre tempère ce jugement de la même manière.
Consommer/produire ne constitue en rien l'ensemble de lavie humaine, ni son bonheur.
D'autres valeurs que l'échange doivent être recherchées dans nos sociétés libérales :le développement durable, le respect de l'environnement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- AU BONHEUR DES DAMES
- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames
- sujet de réflexion au bonheur des dames
- DISSERTATION : AU BONHEUR DES DAMES: Comment Zola applique-t-il le naturalisme dans une œuvre romanesque ?
- Le bonheur(notes de cours)