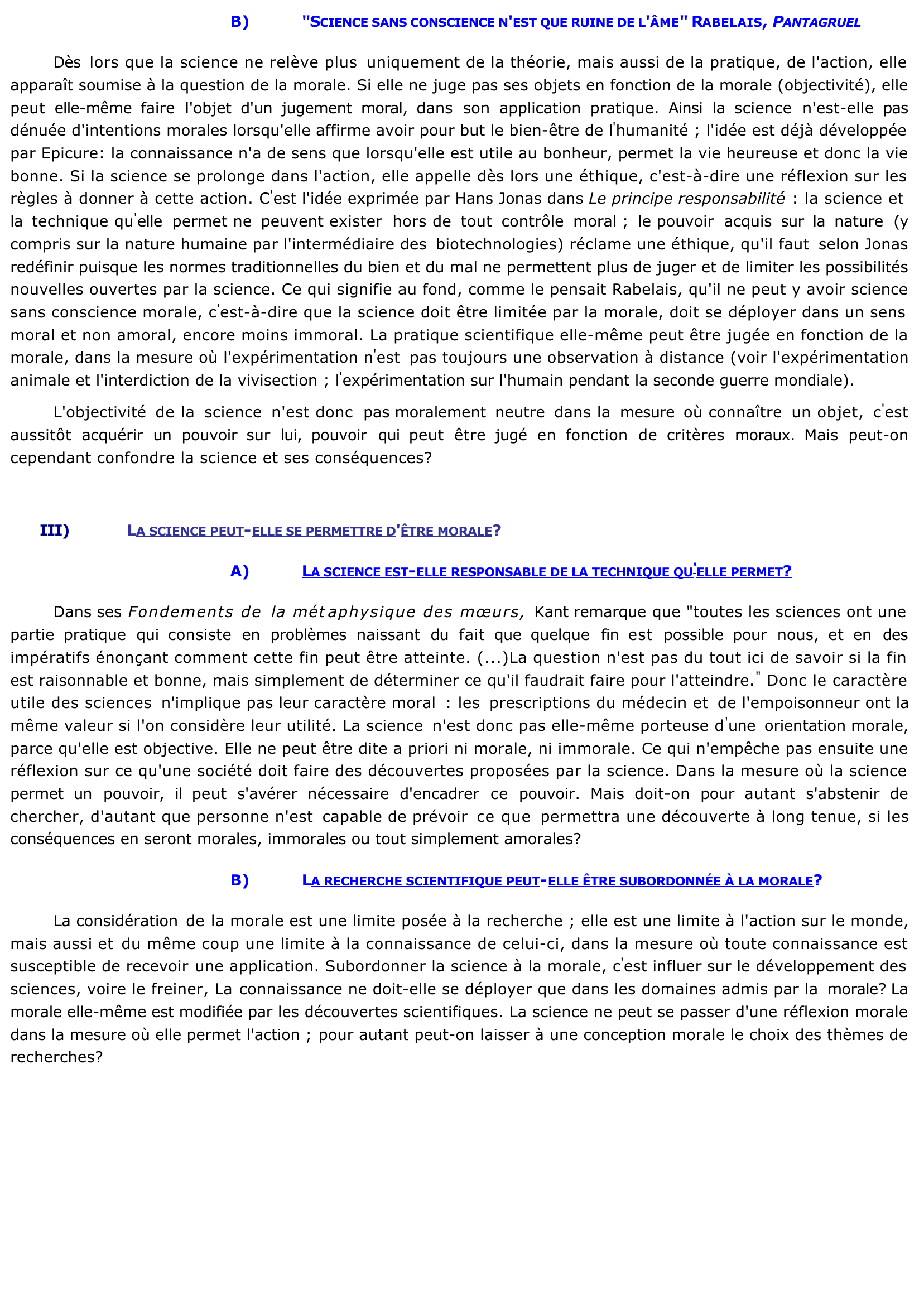Science et neutralité ?
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
B) "SCIENCE SANS CONSCIENCE N 'EST QUE RUINE DE L 'ÂME " RABELAIS , PANTAGRUEL
Dès lors que la science ne relève plus uniquement de la théorie, mais aussi de la pratique, de l'action, elle apparaît soumise à la question de la morale.
Si elle ne juge pas ses objets en fonction de la morale (objectivité), ellepeut elle-même faire l'objet d'un jugement moral, dans son application pratique.
Ainsi la science n'est-elle pasdénuée d'intentions morales lorsqu'elle affirme avoir pour but le bien-être de l 'humanité ; l'idée est déjà développée par Epicure: la connaissance n'a de sens que lorsqu'elle est utile au bonheur, permet la vie heureuse et donc la viebonne.
Si la science se prolonge dans l'action, elle appelle dès lors une éthique, c'est-à-dire une réflexion sur lesrègles à donner à cette action.
C 'est l'idée exprimée par Hans Jonas dans Le principe responsabilité : la science et la technique qu 'elle permet ne peuvent exister hors de tout contrôle moral ; le pouvoir acquis sur la nature (y compris sur la nature humaine par l'intermédiaire des biotechnologies) réclame une éthique, qu'il faut selon Jonasredéfinir puisque les normes traditionnelles du bien et du mal ne permettent plus de juger et de limiter les possibilitésnouvelles ouvertes par la science.
Ce qui signifie au fond, comme le pensait Rabelais, qu'il ne peut y avoir sciencesans conscience morale, c 'est-à-dire que la science doit être limitée par la morale, doit se déployer dans un sens moral et non amoral, encore moins immoral.
La pratique scientifique elle-même peut être jugée en fonction de lamorale, dans la mesure où l'expérimentation n 'est pas toujours une observation à distance (voir l'expérimentation animale et l'interdiction de la vivisection ; l 'expérimentation sur l'humain pendant la seconde guerre mondiale).
L'objectivité de la science n'est donc pas moralement neutre dans la mesure où connaître un objet, c 'est aussitôt acquérir un pouvoir sur lui, pouvoir qui peut être jugé en fonction de critères moraux.
Mais peut-oncependant confondre la science et ses conséquences?
III) LA SCIENCE PEUT -ELLE SE PERMETTRE D 'ÊTRE MORALE ?
A) LA SCIENCE EST -ELLE RESPONSABLE DE LA TECHNIQUE QU 'ELLE PERMET ?
Dans ses Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant remarque que "toutes les sciences ont une partie pratique qui consiste en problèmes naissant du fait que quelque fin est possible pour nous, et en desimpératifs énonçant comment cette fin peut être atteinte.
(...)La question n'est pas du tout ici de savoir si la finest raisonnable et bonne, mais simplement de déterminer ce qu'il faudrait faire pour l'atteindre. " Donc le caractère utile des sciences n'implique pas leur caractère moral : les prescriptions du médecin et de l'empoisonneur ont lamême valeur si l'on considère leur utilité.
La science n'est donc pas elle-même porteuse d 'une orientation morale, parce qu'elle est objective.
Elle ne peut être dite a priori ni morale, ni immorale.
Ce qui n'empêche pas ensuite uneréflexion sur ce qu'une société doit faire des découvertes proposées par la science.
Dans la mesure où la sciencepermet un pouvoir, il peut s'avérer nécessaire d'encadrer ce pouvoir.
Mais doit-on pour autant s'abstenir dechercher, d'autant que personne n'est capable de prévoir ce que permettra une découverte à long tenue, si lesconséquences en seront morales, immorales ou tout simplement amorales?
B) LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE PEUT -ELLE ÊTRE SUBORDONNÉE À LA MORALE ?
La considération de la morale est une limite posée à la recherche ; elle est une limite à l'action sur le monde, mais aussi et du même coup une limite à la connaissance de celui-ci, dans la mesure où toute connaissance est susceptible de recevoir une application.
Subordonner la science à la morale, c 'est influer sur le développement des sciences, voire le freiner, La connaissance ne doit-elle se déployer que dans les domaines admis par la morale? La morale elle-même est modifiée par les découvertes scientifiques.
La science ne peut se passer d'une réflexion morale dans la mesure où elle permet l'action ; pour autant peut-on laisser à une conception morale le choix des thèmes de recherches?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA SCIENCE DE LA LANGUE ET LE STRUCTURALISME
- Peut-on tout attendre de la science ?
- La science ne vise-t-elle que la satisfaction de notre désir de savoir ?
- dissertation philo science et religion: Pourquoi le développement scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions ?
- Exposé philosophique: Science et Technique