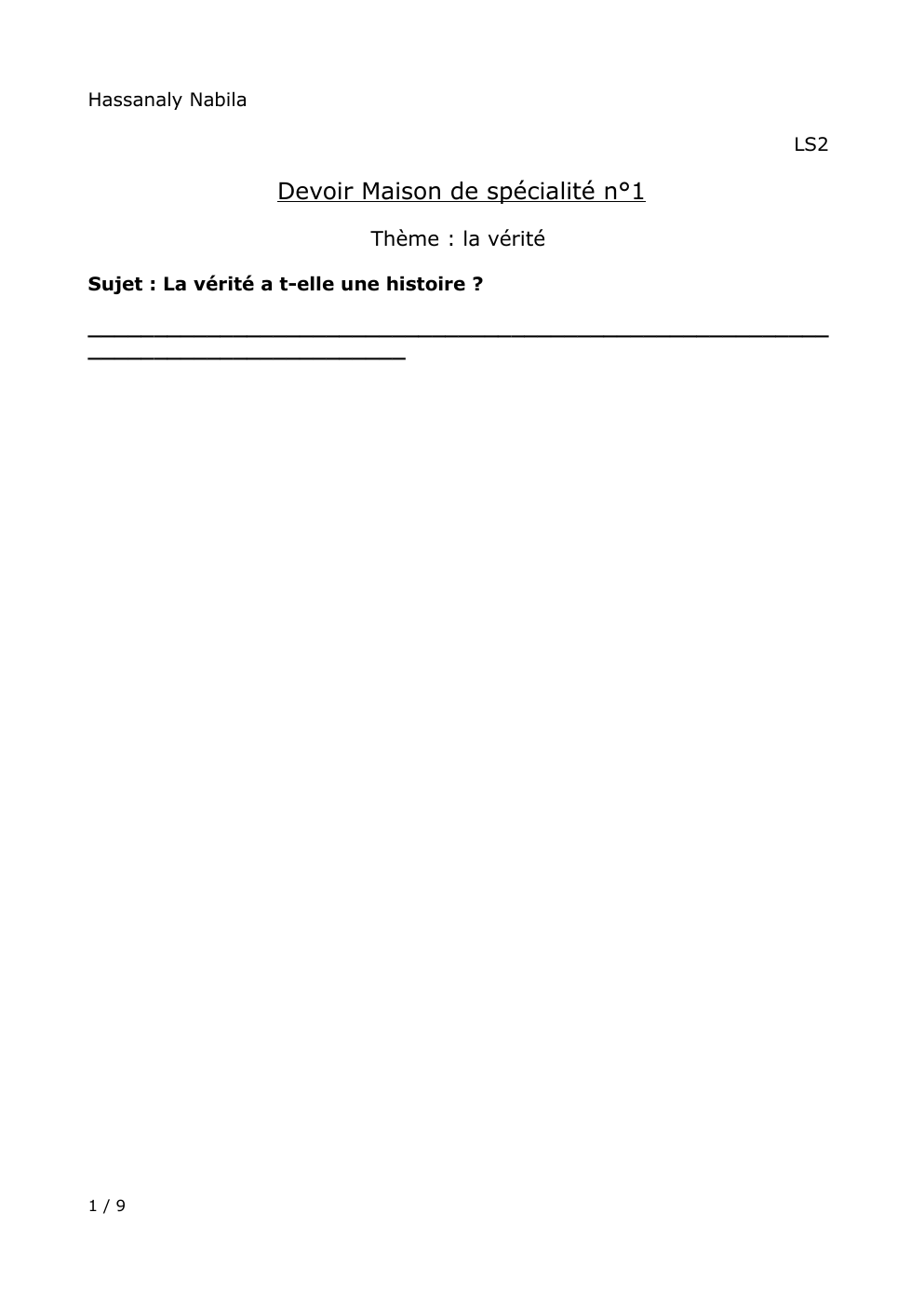Sujet : La vérité a t-elle une histoire ?
Publié le 21/10/2025
Extrait du document
«
Devoir Maison de spécialité n°1
Thème : la vérité
Sujet : La vérité a t-elle une histoire ?
________________________________________________________
________________________
1/9
En 1600, Giordano Bruno, condamné par l’Inquisition pour des positions
contraires à celles des Saintes Écritures, meurt brûlé vif : il paie de sa vie son
soutien à la théorie copernicienne selon laquelle la terre n’est pas au centre du
système solaire.
Ce que Bruno affirme comme étant la vérité à propos de la
structure de l’univers est contesté par l’autorité religieuse, qui se positionne en
faveur de la vérité présentée dans la Bible ; si l’acception à laquelle adhère
l’ancien moine dominicain se voit considérée comme conforme à la réalité et
qu’elle devient, dans les siècles postérieurs à sa mort, la position avérée de
l’homme moderne, Bruno a-t-il été un martyr de la vérité au cours du
processus de construction de la découverte scientifique ? Face à l’évolution des
connaissances scientifiques et à l’acception politique de la vérité qui évolue
constamment, il semble légitime de se demander : la vérité a t-elle une
histoire ?
De prime abord, s’interroger sur une histoire de la vérité implique de
distinguer les faits et le rapport qu’entretient le sujet avec les objets du réel
qui l’entourent.
En effet, si les objets ou les évènements que rencontre le sujet
peuvent être réels ou imaginaires, il semble erroné d’affirmer qu’ils sont vrais
ou faux en eux-même ; la vérité se tiendrait donc dans la correspondance
entre l’idée que le sujet se fait d’une chose - qui découle alors de la perception
qu’il en a - et la chose elle-même : une proposition peut ainsi être vraie ou
fausse par rapport au phénomène que le sujet désigne à travers son langage.
Si la correspondance semble être le critère qui permet de distinguer le vrai du
faux, questionner l’histoire - ou le progrès - de la vérité implique de se pencher
sur la nature essentielle de la vérité : en effet, si la véracité d’une proposition
dépend d’une adéquation entre le jugement émis par le sujet et la réalité le
sens du mot « vrai » ne varie pas d’une phrase à une autre.
De même, si la
vérité se définit par une relation, affirmer qu’elle a une histoire semble
contradictoire : en effet, le rapport de correspondance ne dépend ni du temps
ni des époques ; ce qui est changeant en revanche, ce sont les étants de la
réalité : il y a par exemple une histoire des hommes.
Dès lors, l’histoire faitelle partie de ce qui fait l’essence de la vérité ? Si l’étude de l’histoire amène à
considérer l’idée du progrès - puisque chaque époque semble apporter quelque
chose de plus à l’humanité, se demander si la vérité a une histoire implique de
supposer l’idée selon laquelle la vérité évolue continuellement, et qu’elle est
relative à chaque époque.
La vérité n’est-elle pas caractérisée par ce qui est
nécessaire et absolu - et donc, trans-historique ? Le fait d’admettre une
évolution constante du concept même de vérité ne reviendrait-il pas à n’être
jamais sûr de rien et, par là même, à tomber dans un relativisme permanent ?
Si tel est le cas, il semble convenir de plusieurs vérités, et non de « la » vérité,
absolue et nécessaire.
Dès lors, si la vérité semble s’opposer à l’erreur, à
l’illusion et au mensonge, le progrès de l’humanité vers la connaissance - qui
implique ces trois facteur du « faux », dans la mesure où il s’agit de dépasser
ses erreurs et ses illusions par le progrès - revient-il à parler d’une histoire de
la vérité ou plutôt d’une évolution des normes épistémiques auxquelles doit
obéir la recherche de la connaissance vraie ? Par là même, l’accès à la vérité
reviendrait soit au système de la révélation, soit à celui de la démonstration :
la distinction entre vérité et croyance semble ainsi nécessaire : celui qui
2/9
considère les Saintes Écritures comme vraies - et ce, envers et contre toute
démonstration rationnelle relative à l’évolution de la recherche scientifique semblerait s’illusionner.
En outre, si la distinction mentionnée entre vérité
révélée et vérité démontrée semble renvoyer à une typologie de différents
types de vérités, le concept de vérité en son essence reste toutefois le même
d’un domaine à un autre.
Les jugements émis sur la réalité en constante évolution peuvent-ils
atteindre ce qui est vrai en soi - de manière absolue et nécessaire - dans les
objets du réel ?
De prime abord, il semble qu'admettre une histoire de la vérité revient à
récuser le concept de vérité lui-même : en effet, comment ce qui est vrai peutil être vrai s'il change constamment avec le temps ? (I) Admettre toutefois la
conception d'une vérité liée au contexte dans lequel elle est exprimée permet
de sortir de la philosophie traditionnelle et de concevoir la vérité comme une
orientation politique, façonnée par le discours ; la vérité admise n'est-elle pas
ancrée dans une tradition culturelle donnée ? (II) L'évolution de la
connaissance ne renvoie t-elle pas plutôt à l'histoire du jugement des hommes
sur le réel, qui posent par là même la vérité comme une valeur attribuée aux
étants dans l’optique de mieux appréhender le réel pour accomplir leur volonté
de puissance ? (III)
***
La vérité étant universelle et nécessaire, elle ne peut être soumise à une
quelconque évolution dans la mesure où elle n’évolue pas au fil du temps.
En effet, selon la logique platonicienne il ne s’agit pas pour l’homme de
découvrir de nouvelles vérités sur le réel mais de se ressouvenir constamment
d’une vérité absolue qui transcende le réel.
Ainsi, pour connaitre les objets qui
nous entourent - c’est à dire pour développer des « croyances vraies
justifiées » selon ce qu’il affirme à travers le personnage de Socrate dans le
Théétète - il s’agit pour Platon de distinguer la réalité sensible de la réalité
intelligible.
Si la première est composée d’objets sans cesse en mouvement c’est à dire, qui changent sans cesse d’état - la seconde renvoie au « monde
des idées » ; il s’agit, en l’occurrence, d’une réalité qui n’est pas soumise au
mouvement mais qui est constituée de formes renvoyant à des entités
absolues.
Avant de naître, l’âme a ainsi pu contempler les idées éternelles et,
ce faisant, connaître le réel en soi.
En s’incarnant, l’âme aurait oublié la
plupart des vérités auxquelles elle aurait eu accès dans la région de
l’intelligible.
Si les expériences humaines peuvent être contingentes et
soumises au progrès, la vérité que l’on atteint à travers l’expérience du réel
reste quant à elle absolue et nécessaire.
En ce sens, il explique dans Le Ménon,
que la définition d’un concept expose « la forme caractéristique identique chez
toutes [les vertus] sans exception » ; là où des exemples d’actions vertueuses
se déclinent dans le monde sensible, le concept de vertu qui caractérise ces
actions reste inchangé dans le monde intelligible.
Dès lors, comment accéder à
la vérité des connaissances immuables si la réalité est faite d’objets sans cesse
en mouvement ? Il s’avère en effet difficile de prononcer un jugement dont la
portée de sa véracité serait absolue ; pourtant, la méthode platonicienne
présentée dans le Théétète permet de se ressouvenir de la vérité grâce à la
3/9
maïeutique ; la conception de la vérité unique et absolue qui transcende la
réalité sensible serait ainsi accessible à tous les hommes.
En effet, il s’agit
dans ce discours sur la connaissance de faire de la figure du philosophe celui
qui permet « d’accoucher les esprits » ; Platon établit ainsi une analogie entre
le travail du philosophe face à la connaissance et le travail de la sage-femme
face à la naissance d’un enfant : « c’est sur l’enfantement de leurs âmes, et
non de leurs corps, que porte [l’examen du philosophe].
» L’accouchement de
l’âme consiste ainsi à se ressouvenir de la vérité à laquelle notre âme aurait eu
accès avant notre naissance.
Pour illustrer l’acte du ressouvenir de l’âme,
Platon met en scène Socrate dans le Ménon, qui appelle un esclave pour
démontrer que la vérité se trouve en tout homme ; la question que Socrate lui
pose porte sur la surface du carré : comment la doubler ? Suite à une série
d’hypothèses fausses, l’âme de l’esclave parvient à se ressouvenir des
propriétés géométriques de la figure, qui sont immuables : il faut partir de la
diagonale du carré pour doubler la surface de la figure.
Les propriétés
mathématiques semblent ainsi porteuses de la vérité absolue et nécessaire ;
peut-on, dès lors, développer une véritable connaissance à propos des autres
objets qui constituent le réel ? Par là même, le fait d’être à l’origine d’une
évolution de la connaissance revient-il à faire évoluer la vérité ? Selon la
définition platonicienne de la connaissance mentionnée, le concept de
connaissance semble inclure le concept de vérité - puisqu’il s’agit d’une
« croyance vraie justifiée » : une connaissance est ainsi, par définition, vraie.
Une histoire....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HISTOIRE ET VÉRITÉ, 1955. Paul Ricœur
- Paul Ricœur, Histoire et Vérité, Seuil, 1955, p. 23-24.
- Y a-t-il une histoire de la vérité?
- L'histoire nous dit-elle la vérité ?
- La vérité scientifique a-t-elle une histoire ?