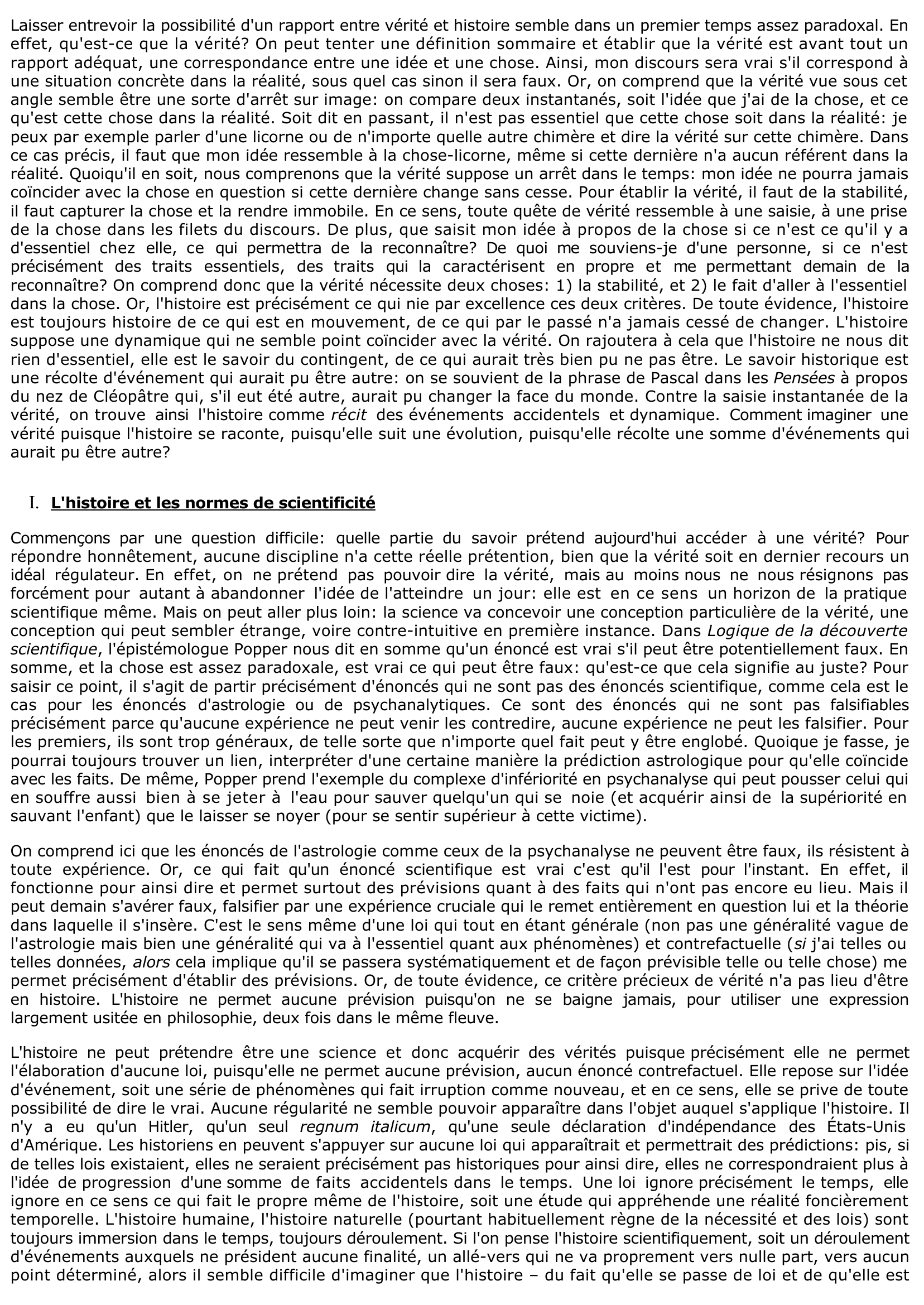Y a-t-il une vérité en histoire ?
Publié le 08/01/2006

Extrait du document


«
Laisser entrevoir la possibilité d'un rapport entre vérité et histoire semble dans un premier temps assez paradoxal.
Eneffet, qu'est-ce que la vérité? On peut tenter une définition sommaire et établir que la vérité est avant tout unrapport adéquat, une correspondance entre une idée et une chose.
Ainsi, mon discours sera vrai s'il correspond àune situation concrète dans la réalité, sous quel cas sinon il sera faux.
Or, on comprend que la vérité vue sous cetangle semble être une sorte d'arrêt sur image: on compare deux instantanés, soit l'idée que j'ai de la chose, et cequ'est cette chose dans la réalité.
Soit dit en passant, il n'est pas essentiel que cette chose soit dans la réalité: jepeux par exemple parler d'une licorne ou de n'importe quelle autre chimère et dire la vérité sur cette chimère.
Dansce cas précis, il faut que mon idée ressemble à la chose-licorne, même si cette dernière n'a aucun référent dans laréalité.
Quoiqu'il en soit, nous comprenons que la vérité suppose un arrêt dans le temps: mon idée ne pourra jamaiscoïncider avec la chose en question si cette dernière change sans cesse.
Pour établir la vérité, il faut de la stabilité,il faut capturer la chose et la rendre immobile.
En ce sens, toute quête de vérité ressemble à une saisie, à une prisede la chose dans les filets du discours.
De plus, que saisit mon idée à propos de la chose si ce n'est ce qu'il y ad'essentiel chez elle, ce qui permettra de la reconnaître? De quoi me souviens-je d'une personne, si ce n'estprécisément des traits essentiels, des traits qui la caractérisent en propre et me permettant demain de lareconnaître? On comprend donc que la vérité nécessite deux choses: 1) la stabilité, et 2) le fait d'aller à l'essentieldans la chose.
Or, l'histoire est précisément ce qui nie par excellence ces deux critères.
De toute évidence, l'histoireest toujours histoire de ce qui est en mouvement, de ce qui par le passé n'a jamais cessé de changer.
L'histoiresuppose une dynamique qui ne semble point coïncider avec la vérité.
On rajoutera à cela que l'histoire ne nous ditrien d'essentiel, elle est le savoir du contingent, de ce qui aurait très bien pu ne pas être.
Le savoir historique estune récolte d'événement qui aurait pu être autre: on se souvient de la phrase de Pascal dans les Pensées à propos du nez de Cléopâtre qui, s'il eut été autre, aurait pu changer la face du monde.
Contre la saisie instantanée de lavérité, on trouve ainsi l'histoire comme récit des événements accidentels et dynamique.
Comment imaginer une vérité puisque l'histoire se raconte, puisqu'elle suit une évolution, puisqu'elle récolte une somme d'événements quiaurait pu être autre?
L'histoire et les normes de scientificitéI.
Commençons par une question difficile: quelle partie du savoir prétend aujourd'hui accéder à une vérité? Pourrépondre honnêtement, aucune discipline n'a cette réelle prétention, bien que la vérité soit en dernier recours unidéal régulateur.
En effet, on ne prétend pas pouvoir dire la vérité, mais au moins nous ne nous résignons pasforcément pour autant à abandonner l'idée de l'atteindre un jour: elle est en ce sens un horizon de la pratiquescientifique même.
Mais on peut aller plus loin: la science va concevoir une conception particulière de la vérité, uneconception qui peut sembler étrange, voire contre-intuitive en première instance.
Dans Logique de la découverte scientifique , l'épistémologue Popper nous dit en somme qu'un énoncé est vrai s'il peut être potentiellement faux.
En somme, et la chose est assez paradoxale, est vrai ce qui peut être faux: qu'est-ce que cela signifie au juste? Poursaisir ce point, il s'agit de partir précisément d'énoncés qui ne sont pas des énoncés scientifique, comme cela est lecas pour les énoncés d'astrologie ou de psychanalytiques.
Ce sont des énoncés qui ne sont pas falsifiablesprécisément parce qu'aucune expérience ne peut venir les contredire, aucune expérience ne peut les falsifier.
Pourles premiers, ils sont trop généraux, de telle sorte que n'importe quel fait peut y être englobé.
Quoique je fasse, jepourrai toujours trouver un lien, interpréter d'une certaine manière la prédiction astrologique pour qu'elle coïncideavec les faits.
De même, Popper prend l'exemple du complexe d'infériorité en psychanalyse qui peut pousser celui quien souffre aussi bien à se jeter à l'eau pour sauver quelqu'un qui se noie (et acquérir ainsi de la supériorité ensauvant l'enfant) que le laisser se noyer (pour se sentir supérieur à cette victime).
On comprend ici que les énoncés de l'astrologie comme ceux de la psychanalyse ne peuvent être faux, ils résistent àtoute expérience.
Or, ce qui fait qu'un énoncé scientifique est vrai c'est qu'il l'est pour l'instant.
En effet, ilfonctionne pour ainsi dire et permet surtout des prévisions quant à des faits qui n'ont pas encore eu lieu.
Mais ilpeut demain s'avérer faux, falsifier par une expérience cruciale qui le remet entièrement en question lui et la théoriedans laquelle il s'insère.
C'est le sens même d'une loi qui tout en étant générale (non pas une généralité vague del'astrologie mais bien une généralité qui va à l'essentiel quant aux phénomènes) et contrefactuelle ( si j'ai telles ou telles données, alors cela implique qu'il se passera systématiquement et de façon prévisible telle ou telle chose) me permet précisément d'établir des prévisions.
Or, de toute évidence, ce critère précieux de vérité n'a pas lieu d'êtreen histoire.
L'histoire ne permet aucune prévision puisqu'on ne se baigne jamais, pour utiliser une expressionlargement usitée en philosophie, deux fois dans le même fleuve.
L'histoire ne peut prétendre être une science et donc acquérir des vérités puisque précisément elle ne permetl'élaboration d'aucune loi, puisqu'elle ne permet aucune prévision, aucun énoncé contrefactuel.
Elle repose sur l'idéed'événement, soit une série de phénomènes qui fait irruption comme nouveau, et en ce sens, elle se prive de toutepossibilité de dire le vrai.
Aucune régularité ne semble pouvoir apparaître dans l'objet auquel s'applique l'histoire.
Iln'y a eu qu'un Hitler, qu'un seul regnum italicum , qu'une seule déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique.
Les historiens en peuvent s'appuyer sur aucune loi qui apparaîtrait et permettrait des prédictions: pis, side telles lois existaient, elles ne seraient précisément pas historiques pour ainsi dire, elles ne correspondraient plus àl'idée de progression d'une somme de faits accidentels dans le temps.
Une loi ignore précisément le temps, elleignore en ce sens ce qui fait le propre même de l'histoire, soit une étude qui appréhende une réalité foncièrementtemporelle.
L'histoire humaine, l'histoire naturelle (pourtant habituellement règne de la nécessité et des lois) sonttoujours immersion dans le temps, toujours déroulement.
Si l'on pense l'histoire scientifiquement, soit un déroulementd'événements auxquels ne président aucune finalité, un allé-vers qui ne va proprement vers nulle part, vers aucunpoint déterminé, alors il semble difficile d'imaginer que l'histoire – du fait qu'elle se passe de loi et de qu'elle est.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HISTOIRE ET VÉRITÉ, 1955. Paul Ricœur
- Paul Ricœur, Histoire et Vérité, Seuil, 1955, p. 23-24.
- Y a-t-il une histoire de la vérité?
- L'histoire nous dit-elle la vérité ?
- La vérité scientifique a-t-elle une histoire ?