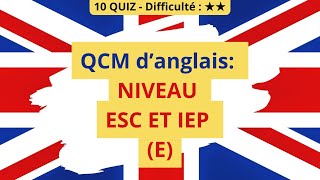Cours: LE DROIT ET LA MORALE
Publié le 22/02/2012

Extrait du document

LE DROIT.
A) Le droit positif et le droit moral:
L'idée de droit implique toujours l'idée de conformité à une règle; mais cette conformité elle-même peut être entendue en deux sens: un droit est ce qui est permis par une règle soit ce qui exigible au nom d'une règle. Encore est-il que le respect de la règle peut être un décret légal ou une loi morale. De là naît l'opposition entre droit positif et droit moral.
1) Le droit positif repose sur la législation. En ce sens, un droit, c'est ce qui est permis par une règle de fait (ainsi une loi en vigueur) ou exigible au nom de cette règle. Le droit sera l'ensemble des règles effectives, des lois qui régissent les rapports entre les hommes.
2) Le droit moral repose sur une règle idéale, morale, c'est-à-dire sur le sentiment de ce qui est légitimement permis ou exigible. Il existe en effet un sentiment du droit, qui semble être un des principaux éléments de la conscience morale. Ce sentiment se présente sous deux formes: il peut être le sentiment de mon droit; il est alors la conviction sincère que j'ai de pouvoir légitimement exiger une chose, accomplir un acte. Il peut être le sentiment du droit d'autrui: il se présente alors comme une sorte de force morale, capable de faire échec à mes impulsions, à mes désirs. A ce point de vue moral, le droit, c'est ce qui devrait légitimement exister. La conscience morale conçoit en effet un ordre idéal, qu'elle juge supérieur à l'ordre réel. Telle est l'opposition du fait et du droit.
B) Interprétations positives du droit:
Mais, l'idée de droit moral est imprécise. Ce que tel homme revendique comme légitime peut ne pas sembler légitime à tel autre. Aussi, certains ont-ils cru devoir ramener tout droit à un droit positif.
1) Déjà Hobbes avait ramené le droit à la force. Un des caractères essentiels du droit est d'être exigible. Mais, l'idée d'un droit purement moral implique qu'il y a des choses "exigibles" qui ne peuvent être exigées. Le droit moral est un "pouvoir" qui ne peut rien. Sa prétendue légitimité n'est donc qu'une illusion. Pour être réel, un droit doit s'exercer. C'est donc la force qui est la mesure du droit. Au nom de principes métaphysiques, voyant dans le réel le développement nécessaire de l'Idée, Hegel est arrivé à des conclusions analogues: il voit dans la force l'expression visible du droit.
Toutefois, ramener le droit à la force, ce n'est pas expliquer le droit, c'est le nier. S'il faut admettre que, lorsque cesse la force, cesse le droit, si tout se réduit à des rapports de force, si l'homme qui, aujourd'hui, est dans son droit parce qu'il est le plus fort, cesse demain d'être dans son droit parce qu'il a trouvé son maître, le mot même de droit ne signifie plus rien. Donc, il est de fait qu'à la force la conscience oppose le droit.
2) Certains ont essayé de rendre compte de ce sentiment du droit en le ramenant à la conscience d'un besoin. Le droit serait fondé sur le besoin et la règle du droit serait: "à chacun selon ses besoins". Mais, il faut avouer que la notion de besoin est fort imprécise. Comment distinguer les véritables besoins, permanents et stables, des désirs passagers et contradictoires? Quant à la règle "à chacun selon ses désirs", elle ne pourrait devenir celle du droit qu'en un état de choses où tous les désirs des hommes pourraient être comblés. Or, un tel état semble impossible, ne serait-ce que par le fait que les désirs de plusieurs individus peuvent s'opposer.
Du reste, la notion de droit ne saurait se confondre avec celle du besoin. Nos besoins sont sentis comme des "faits"; ce sont des tendances personnelles et contingentes. Au contraire, le droit exige un ordre universellement valable. Nous ne nous contentons pas d'affirmer que ce que nous réclamons est conforme à l'un de nos désirs, mais encore au Bien ou au Juste.
3) Les sociologues veulent rendre compte du "sentiment du droit" en invoquant l'influence de la société sur les consciences individuelles. C'est la société qui crée le droit; celui-ci a sa source dans la volonté sociale et dans ses expressions premières: règles religieuses, lois, coutumes, moeurs. S'il apparaît aux consciences individuelles comme idéal, légitime, sans conditions, c'est parce que les impératifs de la conscience collective apparaissent aux individus avec un caractère sacré. S'il existe des droits de l'individu, c'est que le développement des sociétés s'est opéré de telle sorte que l'individu a joué un rôle de plus en plus grand dans la vie sociale. L'affirmation de la valeur de la personne humaine est donc elle-même une création sociale. En un sens différent, mais analogue, certains marxistes, expliquant l'affirmation morale de droits individuels par le moment historique où elle fut formulée, lui refusent tout caractère universel, et subordonnent les droits de l'individu à l'histoire.
Mais, si la source de tout droit est dans la société, comment se fait-il que l'individu soit capable d'affirmer comme légitime un ordre distinct de l'ordre social dans lequel il vit, voire opposé à lui? Verra-t-on en ceci, avec les marxistes, l'expression d'une classe dont l'importance réelle n'est pas encore politiquement reconnue? Mais, si l'ordre affirmé exprime seulement les intérêts de classe, pourquoi est-il ressenti par la conscience comme valable en soi, et comme universel?
Or, tel est bien le cas: la conscience humaine a toujours critiqué les impératifs sociaux au nom d'impératifs moraux, conçus comme supérieurs à eux et comme métaphysiquement fondés. Déjà, dans l'antiquité, nous voyons l'Antigone de Sophocle, après avoir enseveli son frère malgré la défense de Créon, répondre à ce dernier: "Je n'ai pas cru que tes ordres eussent assez de force pour que des lois non écrites, mais impérissables, émanées des dieux, dussent fléchir sous un mortel". Et, il arrive souvent qu'une règle sociale nous semble injuste, et qu'au droit légal nous opposions mentalement un droit moral dont la légitimité nous paraît inconditionnée.
C) Interprétations morales du droit:
Aussi certains moralistes, faisant confiance à cette impression de légitimité éprouvée par notre conscience, ont-ils cru à la spécificité et à la valeur d'un droit purement moral. Parfois, ce droit coïncide avec le droit positif. Mais, parfois il en diffère, et la conscience revendique comme légitimes des droits que la société ne lui reconnaît pas. Cette opposition de la "vraie justice" et de la "justice sociale" a donné naissance à l'idée de droit naturel. Ce dernier serait un droit inhérent à l'homme, indépendant de toute organisation sociale, saisissable par la seule conscience, et tel que toute atteinte lui étant portée par les lois serait condamnable. L'idée de droit naturel, qui se trouve déjà chez Aristote, a connu une faveur particulière à toutes les époques de revendications et de transformations sociales, en particulier au XVIIième siècle, où on la rencontre chez J.J. Rousseau, dans la déclaration des droits de l'homme, ect.
La théorie kantienne donne aussi du droit une interprétation toute morale. Kant voit dans le droit un a priori supérieur au fait, et le fonde sur la raison pure. L'homme est inviolable parce qu'il est raisonnable, parce qu'il est "sujet de la loi morale". Cette théorie, on le voit, revient à fonder le droit sur le devoir. Ce dernier est l'élément premier, la base de toute moralité. C'est en tant qu'il est sujet de la loi morale que l'homme est sacré, c'est parce qu'il a des devoirs qu'il a des droits.
Or, il n'en est pas ainsi: car nous sentons le droit d'accomplir des actes auxquels nous nous sentons nullement obligés par devoir.
Les adversaires les plus résolus de la notion de droit naturel sont les sociologues. Pour eux, cette notion est dénuée de tout fondement. Sans doute, l'ordre idéal que notre conscience oppose parfois à l'ordre établi nous apparaît-il comme universellement et éternellement légitime; mais il ne s'agit là que d'une impression subjective. Non seulement, en effet, il n'y a pas un droit qui, en tous temps et lieux, ait été reconnu à l'homme, mais il n'y a pas même un droit que, toujours et partout, la conscience humaine ait revendiqué. Ce n'est que peu à peu que le droit s'est individualisé (c'est-à-dire qu'il a pris pour sujet non plus le groupe, mais l'individu), ce n'est que peu à peu qu'il s'est universalisé (autrement dit valable pour tous). Ce qui nous semble légitime n'a pas semblé légitime à des hommes ayant vécu en d'autres temps, sous d'autres climats.
Et sans doute faut-il accorder aux sociologues qu'on ne saurait donner au droit moral aucun fondement objectif. Notre conscience oppose au droit légal un droit moral qu'elle conçoit comme éternellement et universellement valable. Mais, tout se réduit ici à une impression subjective: le droit moral semble n'avoir d'autre base que le sentiment que nous avons de ce qui est légitime, n'être fondé que sur l'idée que nous nous faisons du Bien.
Mais en conclure qu'il n'est rien, c'est prétendre résoudre la question avant de l'avoir posée. Tout le problème, en effet, est là. Les interprétations positives du droit s'évertuent à montrer que la notion de droit moral est vide de sens parce que le droit moral n'est pas un fait, n'existe pas à titre de concrète. Or, il est clair que si la notion de droit a quelque sens, c'est justement celui d'une valeur opposée au fait, et supérieure à lui.
L'idée de droit témoigne donc de la supériorité essentielle de l'esprit sur la Nature, du pouvoir qu'à l'esprit de dépasser tout état de fait, d'opposer à ce qui est ce qui devrait être, autrement dit de concevoir le Bien. A l'état de fait, notre esprit préfère un ordre de droit, qu'il conçoit comme universellement valable, et que notre tâche est de le réaliser dans la mesure de nos moyens. Il y a là une donnée essentielle de notre conscience morale, injustifiable, sans doute, par les méthodes de la science, qui, par définition, n'atteignent que le fait, mais possédant une évidence propre, engendrant une "certitude morale", seule certitude possible en ce qui concerne les Valeurs.
La reconnaissance, par ma conscience, d'un ordre idéal implique en effet pour moi l'obligation d'accomplir les actes propres à réaliser cet ordre: telle est la source du devoir. La simple reconnaissance d'un ordre idéal désirable ne suffit pas en effet à entraîner sa réalisation: bien des forces en moi, bien des tendances égoïstes peuvent s'y opposer; aussi le sentiment du devoir traduit-il une sorte de conflit, et la réalisation du devoir suppose-t-elle une certaine contrainte. Encore est-il que, si conflit il y a, il est intérieur à ma conscience: il oppose l'aspiration que j'ai vers l'ordre que je conçois comme le Bien, et le désir que je puis avoir de biens qui ne seraient que mes biens.
Conclusion:
Le droit et le devoir ne sont que les deux aspects de cette réalité morale qui nous apparaît sous la forme du Bien. Le droit est ce qui est dû au sujet moral, le devoir ce qu'il doit lui-même. En effet, un ordre idéal étant posé par la conscience, et considéré par elle comme bon, je puis exiger certaines choses au nom de cet idéal: tel sera mon droit; mais je dois admettre aussi que d'autres, au nom de cet idéal, c'est-à-dire au nom de leur droit, exigent de moi certains actes, ceux-ci constituant mon devoir. Tout droit chez un homme implique un devoir chez les autres.
Liens utiles
- personne morale (cours de droit civil).
- Cours Droit Morale
- DROIT ADMINISTRATIF - cours complet
- justice et droit (cours)
- le droit commercial (cours complet)