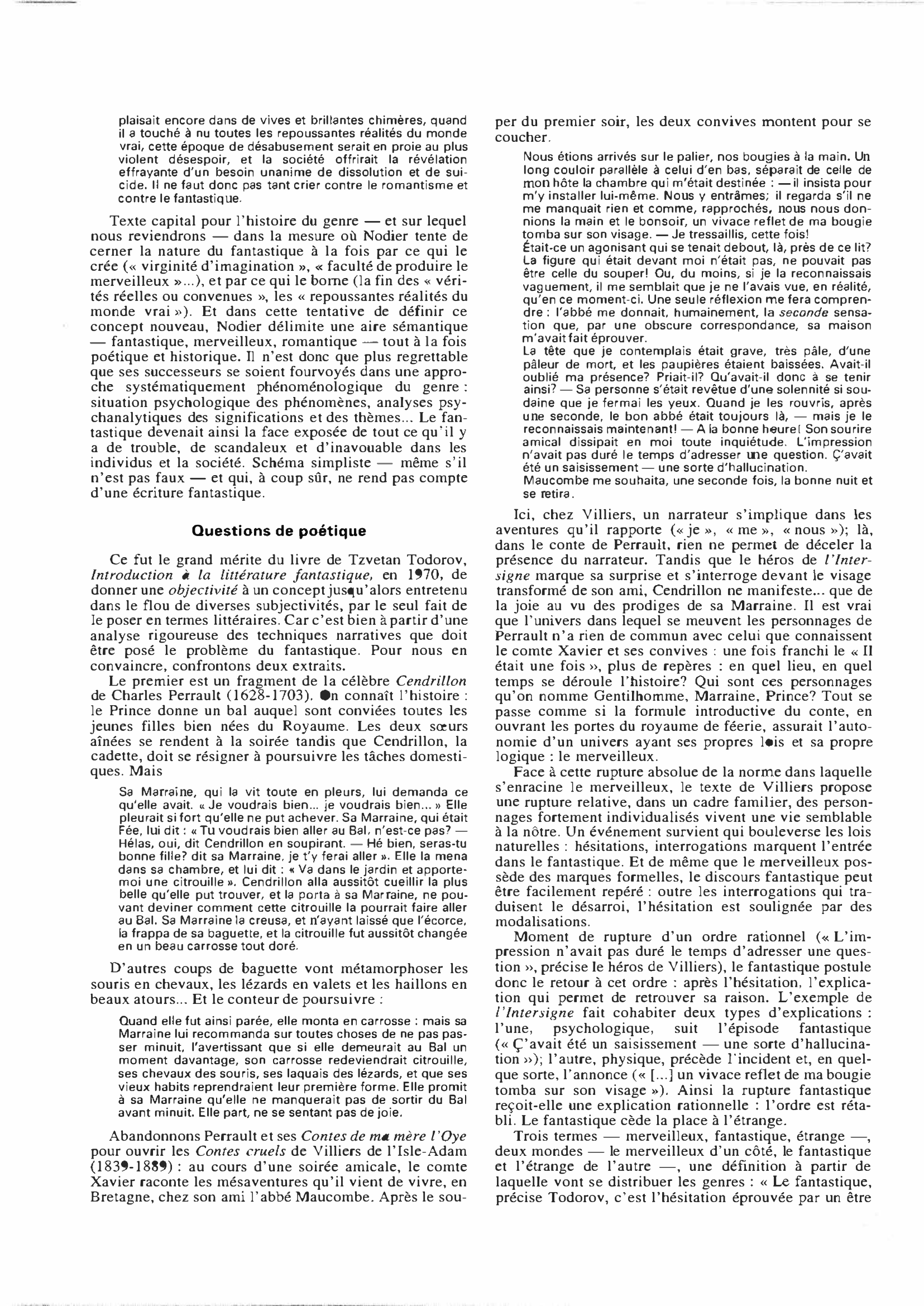FANTASTIQUE (Histoire de la littérature)
Publié le 05/12/2018

Extrait du document

FANTASTIQUE. Il en va du fantastique comme du romantisme : le sens premier s’est perdu, qui faisait du mot un concept précis; et à recouvrir progressivement trop de choses le terme est devenu flou, sinon vide. Si l’on s’accorde facilement à reconnaître en Jérôme Bosch un peintre fantastique, qui pourra préciser en quoi consiste le fantastique de tel ou tel tableau — sauf à énumérer une liste de créatures qui dans un conte de Perrault permettraient de caractériser le ... merveilleux? Et les ogres de ce même Perrault sont-ils vraiment différents de Dracula, l’une des vedettes incontestées de l’écran fantastique?
Question de sémantique
Au commencement est la fantaisie — comme le roman est à la source du romantique. Au Moyen Age, la fantaisie désigne l’imagination et tout ce qu’elle engendre. C’est ce sens étymologique (en grec, phantasia signifie « imaginaire ») qu’utilise Balzac au xixc siècle lorsqu’il parle de son héros « plongé dans une rêverie mêlée de veille et de sommeil qui prête aux réalités les apparences de la fantaisie et donne aux chimères le relief de l’existence » {la Peau de Chagrin, 1831). Réalité, fantaisie, chimère... c’est déjà le balisage du parcours fantastique qui s’ordonne. L'adjectif suit naturellement le nom : au xivc siècle, fantastique apparaît avec un sens qui traverse toute l’époque classique : ainsi, lorsqu’Énée croise aux Enfers les ombres des morts, le poète Scarron le prévient par la bouche de la prêtresse d’Apollon :
Monsieur Enéas, prenez garde
Dit la Sybille; ces vilains
Sont corps fantastiques et vains Qui découpés ne peuvent être...
(le Virgile travesti, 1659)
Le glissement est logique qui conduit de la faculté d’imaginer au(x) produit(s) imaginé(s) en quoi l’on voit souvent extravagance et bizarrerie. Rien d’étonnant, dès lors, que l’un des premiers sens du substantif fantastique ait été celui de « fou, insensé ». Ce n’est qu’avec le xvine siècle finissant, et surtout le romantisme, qu’il entre en littérature : c’est Nodier (1780-1844) qui lui donne ses lettres de noblesse, en en faisant un genre littéraire à part entière dans un article au titre révélateur, Du fantastique en littérature (1830) :
Le fantastique demande à la vérité une virginité d'imagination et de croyances qui manque aux littératures secondaires, et qui ne se reproduit chez elles qu'à la suite de ces révolutions dont le passage renouvelle tout; mais alors, et quand les religions elles-mêmes, ébranlées jusque dans leurs fondements, ne parlent plus à l'imagination, ou ne lui portent que des notions confuses, de jour en jour obscurcies par un scepticisme inquiet, il faut bien que cette faculté de produire le merveilleux dont la nature l'a douée s'exerce sur un genre de création plus vulgaire et mieux approprié aux besoins d'une intelligence matérialisée. L'apparition des fables recommence au moment où finit l'empire de ces vérités réelles ou convenues qui prêtent un reste d'âme au mécanisme usé de la civilisation. Voilà ce qui a rendu le fantastique si populaire en Europe depuis quelques années, et ce qui en fait la seule littérature essentielle de l'âge de décadence ou de transition où nous sommes parvenus. Nous devons même reconnaître en cela un bienfait spontané de notre organisation; car si l'esprit humain ne se com-

«
plaisait
encore dans de vives et brillantes chimères, quand
il a touché à nu toutes les repoussantes réalités du monde
vrai, cette époque de désabusement serait en proie au plus
violent désespoir, et la société offrirait la révélation
effrayante d'un besoin unanime de dissolution et de sui
cide.
Il ne faut donc pas tant crier contre le romantisme et
contre le fantastiq ue.
Texte capital pour l'histoire du genre -et sur lequel
nous reviendrons -dans la mesure où Nodier tente de
cerner la nature du fantastique à la fois par ce qui le
crée («virginité d'imagination »,« faculté de produire le
merveilleux » ...
), et par ce qui le borne (la fin des >, les « repoussantes réalités du
monde vrai >> ).
Et dans cette tentative de définir ce
concept nouveau, Nodier délimite une aire sémantique
- fantastique, merveilleux, romantique -tout à la fois
poétique et historique.
Il n'est donc que plus regrettable
que ses successeurs se soient fourvoyés dans une appro
che systématiquement phénoménologique du genre :
situation psychologique des phénomènes, analyses psy
chanalytiques des significations et des thèmes ...
Le fan
tastique devenait ainsi la face exposée de tout ce qu'il y
a de trouble, de scandaleux et d'inavouable dans les
individus et la société.
Schéma simpliste -même s'il
n'est pas faux -et qui, à coup sûr, ne rend pas compte
d'une écriture fantastique.
Questions de poétique
Ce fut le grand mérite du livre de Tzvetan Todorov,
Introduction à la Littérature fantastique, en 1970, de
donner une objectivité à un concept jusqu'alors entretenu
dans le flou de diverses subjectivités, par le seul fait de
Je poser en termes littéraires.
Car c'est bien à partir d'une
analyse rigoureuse des techniques narratives que doit
être posé le problème du fantastique.
Pour nous en
convaincre, confrontons deux extraits.
Le premier est un fragment de la célèbre Cendrillon
de Charles Perrault (1628-1703 ).
On connaît 1' histoire :
le Prince donne un bal auquel sont conviées toutes les
jeunes filles bien nées du Royaume.
Les deux sœurs
aînées se rendent à la soirée tandis que Cendrillon, la
cadette, doit se résigner à poursuivre les tâches domesti
ques.
Mais
Sa Marrai ne, qui la vit toute en pleurs, lui demanda ce
qu'elle avait.
«Je voudrais bien ...
je voudrais bien ...
» Elle
pleurait si fort qu'elle ne put achever.
Sa Marraine, qui était
Fée, lu i dit : «Tu voudrais bien aller au Bal, n'est-ce pas?
Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant.
-Hé bien, seras-tu
bonne fille? dit sa Marraine, je t'y ferai aller».
Elle la mena
dans sa chambre, et lui dit : «Va dans le jardin et apporte
moi une citrouille».
Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus
belle qu'elle put trouver, et la porta à sa Mar raine, ne pou
vant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller
au Bal.
Sa Marraine la creusa, et n'ayant laissé que l'écorce,
la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée
en un beau carrosse tout doré.
D'autres coups de baguette vont métamorphoser les
souris en chevaux, les lézards en valets et les haillons en
beaux atours ...
Et le conteur de poursuivre :
Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse : mais sa
Marraine lui recommanda sur toutes choses de ne pas pas
ser minuit, l'avertissant que si elle demeurait au Bal un
moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille,
ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses
vieux habits reprendraient leur première forme.
Elle promit
à sa Marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du Bal
avant minuit.
Elle part, ne se sentant pas de joie.
Abandonnons Perrault et ses Contes de ma mère l'Oye
pour ouvrir les Contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam
(1839-1889): au cours d'une soirée amicale, le comte
Xavier raconte les mésaventures qu'il vient de vivre, en
Bretagne, chez son ami l'abbé Maucombe.
Après le sou- per
du premier soir, les deux convives montent pour se
coucher.
Nous étions arrivés sur le palier, nos bougies à la main.
Un
long couloir parallèle à celui d'en bas, séparai t de celle de
m on hôte la chambre qui m'était destinée : -il insista pour
m'y installer lui-même.
Nous y entrâmes; il regarda s'il ne
me manquait rien et comme, rapprochés, no us nous don
nions la main et le bonsoi r, un vivace reflet de ma bougie
tomba sur son visage.
-Je tressaillis, cette fois!
É tai t-ce un agonisant qui se tenait debout, là, près de ce lit?
La figure qui était devant moi n'était pas, ne pouvait pas
être celle du souper! Ou, du moins, si je la reconnaissais
vaguement, il me semblait que je ne l'avais vue, en réalité,
qu'en ce moment-ci.
Une seule réflexion me fera compren
dre : l'abbé me donnait, humainement, la seconde sensa
tion que, par une obscure correspondance, sa maison
m'avait fait éprouver.
La tête que je contemplais était grave, très pâle, d'une
pâleur de mort, et les paupières étaient baissées.
Avait-il
oublié ma présence? Priait-il? Qu'avait-il donc à se tenir
ainsi? -Sa personne s'était revêtue d'une solennité si sou
daine que je fermai les yeux.
Quand je les rouvris, après
u ne seconde, le bon abbé était toujours là, - mais je le
reconnaissais maintenant!-A la bonne heure! Son sourire
amical dissipait en moi toute inquiétude.
L'impression
n'avait pas duré le temps d'adresser une question.
Ç'avait
été un saisissement- une sorte d'hallucination.
Maucombe me souhaita, une seconde fois, la bonne nuit et
se retira .
Ici, chez Villiers, un narrateur s'implique dans les
aventures qu'il rapporte (, « me >>, > ); là,
dans le conte de Perrault, rien ne permet.
de déceler la
présence du narrateur.
Tandis que le héros de l'Inter
signe marque sa surprise et s'interroge devant le visage
transformé de son ami, Cendrillon ne manifeste ...
que de
la joie au vu des prodiges de sa Marraine.
Il est vrai
que l'univers dans lequel se meuvent les personnages de
Perrault n'a rien de commun avec celui que connaissent
le comte Xavier et ses convives : une fois franchi le , plus de repères : en quel lieu, en quel
temps se déroule l'histoire? Qui sont ces personnages
qu'on nomme Gentilhomme, Marraine, Prince? Tout se
passe comme si la formule introductive du conte, en
ouvrant les portes du royaume de féerie, assurait l'auto
nomie d'un univers ayant ses propres lois et sa propre
logique : le merveilleux.
Face à cette rupture absolue de la norme dans laquelle
s'enracine le merveilleux, le texte de Villiers propose
une rupture relative, dans un cadre familjer, des person
nages fortement individualisés vivent une vie semblable
à la nôtre.
Un événement survient qui bouleverse les lois
naturelles : hésitations, interrogations marquent l'entrée
dans le fantastique.
Et de même que Je merveilleux pos
sède des marques formelles, le discours fantastique peut
être facilement repéré : outre les interrogations qui tra
duisent le désarroi, 1 'hésitation est soulignée par des
modalisations.
Moment de rupture d'un ordre rationnel (« L'im
pression n'avait pas duré le temps d'adresser une ques
tion >>,précise le héros de Villiers), le fantastique postule
donc le retour à cet ordre : après l'hésitation, l' explica
tion qui permet de retrouver sa raison.
L'exemple de
l'Intersigne fait cohabiter deux types d'explications :
l'une, psychologique, suit l'épisode fantastique
(« Ç'avait été un saisissement -une sorte d'hallucina
tion>> ); l'autre, physique, précède l'incident et, en quel
que sorte, l'annonce (.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FANTASTIQUE
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours
- ARTHUR et la légende arthurienne (Histoire de la littérature)