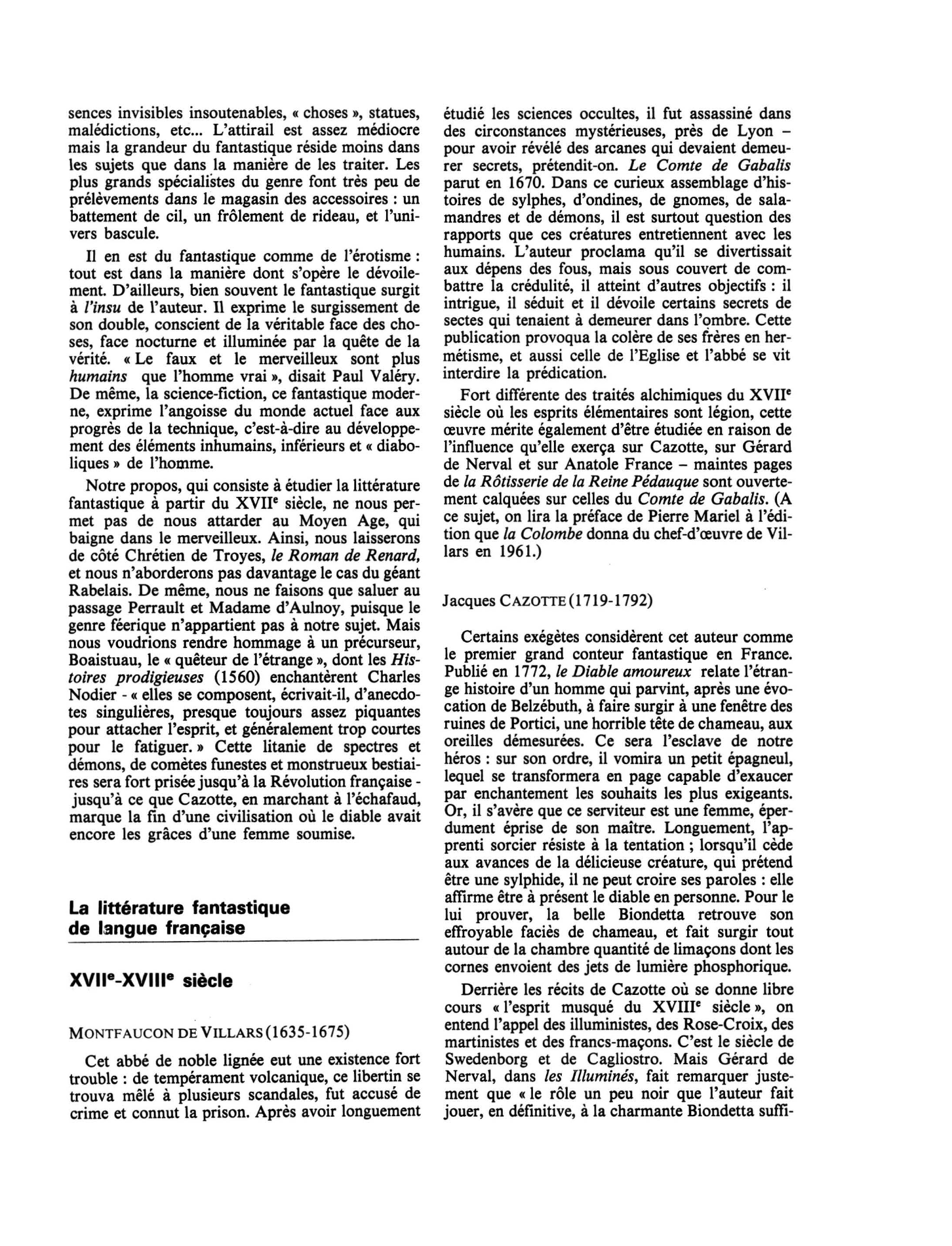HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FANTASTIQUE
Publié le 21/11/2011

Extrait du document

Il en est du fantastique comme de l'érotisme : tout est dans la manière dont s'opère le dévoilement. D'ailleurs, bien souvent le fantastique surgit à l'insu de l'auteur. Il exprime le surgissement de son double, conscient de la véritable face des choses, face nocturne et illuminée par la quête de la vérité. « Le faux et le merveilleux sont plus humains que l'homme vrai «, disait Paul Valéry. De même, la science-fiction, ce fantastique moderne, exprime l'angoisse du monde actuel face aux progrès de la technique, c'est-à-dire au développement des éléments inhumains, inférieurs et « diaboliques « de l'homme. Notre propos, qui consiste à étudier la littérature fantastique à partir du xviie siècle, ne nous permet pas de nous attarder au Moyen Age, qui baigne dans le merveilleux. Ainsi, nous laisserons de côté Chrétien de Troyes, le Roman de Renard, et nous n'aborderons pas davantage le cas du géant Rabelais. De même, nous ne faisons que saluer au passage Perrault et Madame d'Aulnoy, puisque le genre féerique n'appartient pas à notre sujet.

«
sences invisibles insoutenables, « choses », statues,
malédictions, etc ...
L'attirail est assez médiocre
mais la grandeur du fantastique réside moins dans
les sujets que dans la manière de
les traiter.
Les
plus grands spécialistes du genre font très peu de prélèvements dans le magasin des accessoires : un
battement de cil, un frôlement de rideau, et l'uni
vers bascule .
Il en est du fantastique comme de l'érotisme :
tout est dans la manière dont s'opère le dévoile
ment.
D'ailleurs, bien souvent le fantastique surgit à l'insu de l'auteur.
Il exprime le surgissement de
son double, conscient de la véritable face des cho
ses, face nocturne et illuminée par la quête de la
vérité .
« Le faux et le merveilleux sont plus
humains que l'homme vrai », disait Paul Valéry.
De même, la science-fiction, ce fantastique moder ne, exprime l'angoisse du monde actuel face aux
progrès de la technique, c'est-à-dire au développe
ment des éléments inhumains, inférieurs et « diabo liques» de l'homme.
Notre propos, qui consiste à étudier la littérature
fantastique à partir du
xvu• siècle, ne nous per
met pas de nous attarder au Moyen Age, qui
baigne dans le merveilleux.
Ainsi, nous laisserons
de côté Chrétien de Troyes, le Roman de Renard,
et nous n'aborderons pas davantage le cas du géant
Rabelais.
De même, nous ne faisons que saluer au
passage Perrault et Madame d'Aulnoy, puisque le genre féerique n'appartient pas à notre sujet.
Mais
nous voudrions rendre hommage à un précurseur,
Boaistuau,
le « quêteur de l'étrange », dont les His
toires prodigieuses (1560) enchantèrent Charles Nodier-« elles se composent, écrivait-il, d'anecdo
tes singulières, presque toujours assez piquantes
pour attacher l'esprit, et généralement trop courtes
pour le
fatiguer.» Cette litanie de spectres et
démons, de comètes funestes et monstrueux bestiai
res sera fort prisée jusqu'à la Révolution française -
jusqu'à
ce que Cazotte, en marchant à l'échafaud,
marque la fin d'une civilisation où le diable avait
encore les grâces d'une femme soumise.
La littérature fantastique
de
13ngue française
xvu•-xvm• siècle
MONTFAUCON DE VILLARS(1635-1675)
Cet abbé de noble lignée eut une existence fort
trouble : de tempérament volcanique,
ce libertin se trouva mêlé à plusieurs scandales, fut accusé de
crime et connut la prison.
Après avoir longuement étudié
les sciences
occultes, il fut assassiné dans des circonstances mystérieuses, près de Lyon -
pour avoir révélé des arcanes qui devaient demeu
rer secrets, prétendit-on.
Le Comte de Gabalis
parut en
1670.
Dans ce curieux assemblage d'his
toires de sylphes, d'ondines, de gnomes, de sala
mandres et de démons, il est surtout question des
rapports que ces créatures entretiennent avec les
humains.
L'auteur proclama qu'il
se divertissait
aux dépens des fous, mais sous couvert de com
battre la crédulité,
il atteint d'autres objectifs : il intrigue, il séduit et il dévoile certains secrets de
sectes qui tenaient à demeurer dans l'ombre .
Cette
publication provoqua la colère de ses
frères en her
métisme, et aussi celle de l'Eglise et l'abbé
se vit interdire la prédication .
Fort différente des traités alchimiques du
XVII" siècle où les esprits élémentaires sont légion, cette
œuvre mérite également d'être étudiée en raison de l'influence qu'elle exerça sur Cazotte, sur Gérard
de Nerval et sur Anatole France- maintes pages
de la Rôtisserie de la Reine Pédauque sont ouverte
ment calquées sur celles du Comte de Gabalis.
(A ce sujet, on lira la préface de Pierre Marie! à l'édi
tion que la Colombe donna du chef-d'œuvre de Vil lars en 1961.)
Jacques
CAZOTIE ( 1 719-1792)
Certains exégètes considèrent cet auteur comme
le premier grand conteur fantastique en France.
Publié en 1772, le Diable amoureux relate l'étran ge histoire d'un homme qui parvint, après une évo
cation de Belzébuth, à faire surgir à une fenêtre des
ruines de Portici, une horrible tête de chameau, aux
oreilles démesurées.
Ce sera l'esclave de notre
héros : sur son ordre,
il vomira un petit épagneul,
lequel se transformera en page capable d'exaucer
par enchantement les souhaits les plus exigeants.
Or, il s'avère que ce serviteur est une femme, éper
dument éprise de son maître.
Longuement, l'ap
prenti sorcier résiste à la tentation ; lorsqu'il cède
aux avances de la délicieuse créature, qui prétend
être une sylphide,
il ne peut croire ses paroles : elle
affirme être à présent le diable en personne.
Pour le lui prouver, la belle Biondetta retrouve son
effroyable faciès de chameau, et fait surgir tout
autour de la chambre quantité de limaçons dont les
cornes envoient des jets de lumière phosphorique.
Derrière
les récits de Cazotte où se donne libre
cours « l'esprit musqué du XVIII" siècle », on
entend l'appel des illuministes, des Rose-Croix, des
martinistes et des francs-maçons.
C'est le siècle de
Swedenborg et de Cagliostro.
Mais Gérard de
Nerval, dans
les Illuminés, fait remarquer juste
ment que « le rôle un peu noir que l'auteur fait
jouer, en définitive, à la charmante Biondetta suffi-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FANTASTIQUE (Histoire de la littérature)
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours
- ARTHUR et la légende arthurienne (Histoire de la littérature)