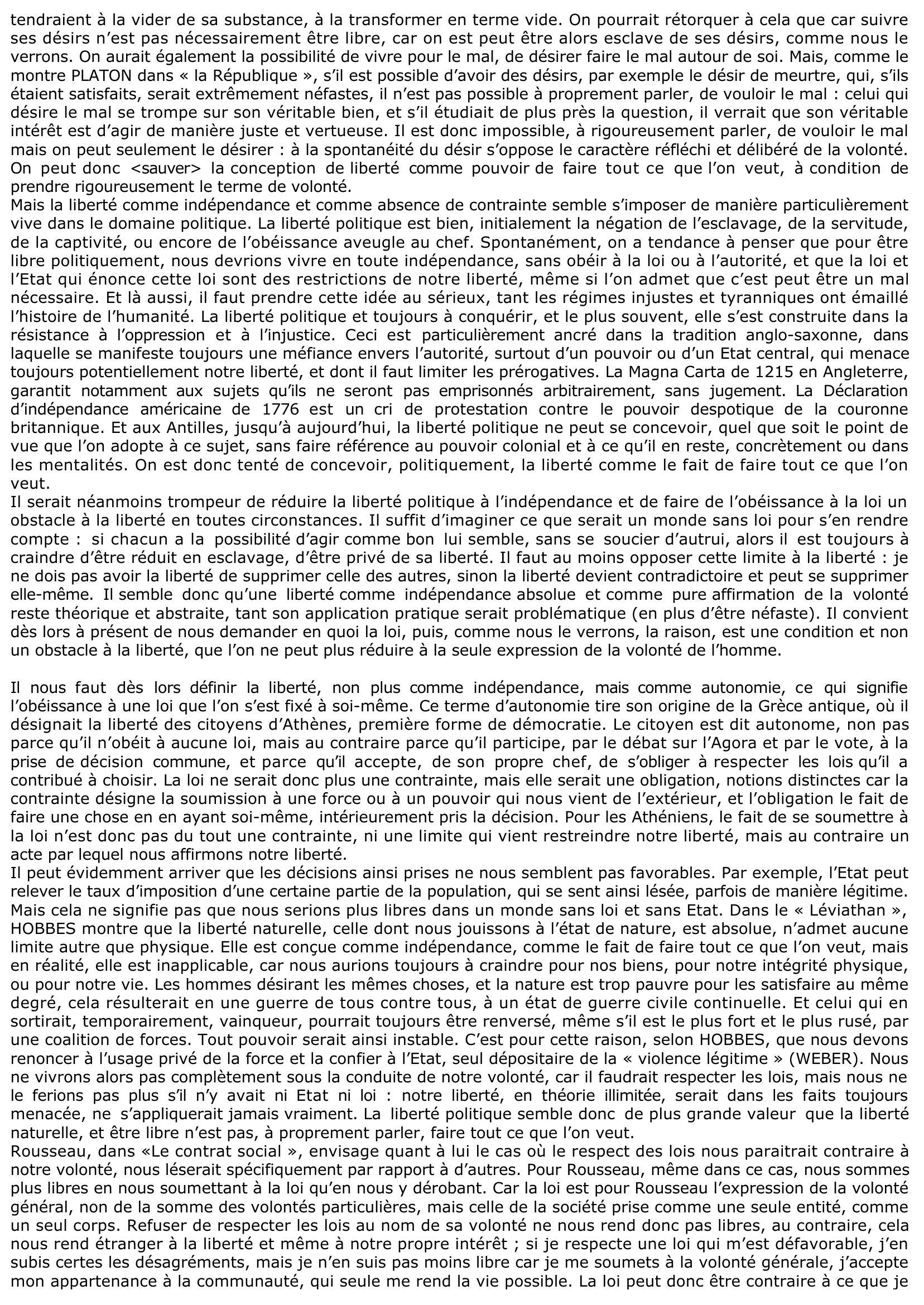ETRE LIBRE, EST-CE FAIRE TOUT CE QUE L'ON VEUT ?
Publié le 08/11/2011

Extrait du document
Spontanément, on peut être tenté de définir la liberté comme le pouvoir de se déterminer sans aucune contrainte, d’agir comme bon nous semble, sans nous soucier des contraintes qui peuvent venir entraver notre action. On assimile alors la liberté à l’indépendance : être libre, ce serait ne dépendre de rien ni de personne, avoir toute l’attitude de se déterminer par soi-même. La liberté apparaît alors comme un pouvoir illimité. Cette définition de la liberté comme un absolu peut s’appliquer à cette notion en tant qu’elle concerne l’action humaine en général, auquel cas elle serait le pouvoir de s’abstraire de toute cause ou raison nous poussant à agir d’une certaine manière, comme à la liberté en tant que notion politique, ce qui la rendrait contraire à toute d’obéissance et de loi. En outre, cela fait reposer la notion de liberté sur la volonté, entendue comme faculté de se décider, d’opérer des choix sans entrave.
«
tendraient à la vider de sa substance, à la transformer en terme vide.
On pourrait rétorquer à cela que car suivreses désirs n’est pas nécessairement être libre, car on est peut être alors esclave de ses désirs, comme nous leverrons.
On aurait également la possibilité de vivre pour le mal, de désirer faire le mal autour de soi.
Mais, comme lemontre PLATON dans « la République », s’il est possible d’avoir des désirs, par exemple le désir de meurtre, qui, s’ilsétaient satisfaits, serait extrêmement néfastes, il n’est pas possible à proprement parler, de vouloir le mal : celui quidésire le mal se trompe sur son véritable bien, et s’il étudiait de plus près la question, il verrait que son véritableintérêt est d’agir de manière juste et vertueuse.
Il est donc impossible, à rigoureusement parler, de vouloir le malmais on peut seulement le désirer : à la spontanéité du désir s’oppose le caractère réfléchi et délibéré de la volonté.On peut donc la conception de liberté comme pouvoir de faire tout ce que l’on veut, à condition deprendre rigoureusement le terme de volonté.Mais la liberté comme indépendance et comme absence de contrainte semble s’imposer de manière particulièrementvive dans le domaine politique.
La liberté politique est bien, initialement la négation de l’esclavage, de la servitude,de la captivité, ou encore de l’obéissance aveugle au chef.
Spontanément, on a tendance à penser que pour êtrelibre politiquement, nous devrions vivre en toute indépendance, sans obéir à la loi ou à l’autorité, et que la loi etl’Etat qui énonce cette loi sont des restrictions de notre liberté, même si l’on admet que c’est peut être un malnécessaire.
Et là aussi, il faut prendre cette idée au sérieux, tant les régimes injustes et tyranniques ont émaillél’histoire de l’humanité.
La liberté politique et toujours à conquérir, et le plus souvent, elle s’est construite dans larésistance à l’oppression et à l’injustice.
Ceci est particulièrement ancré dans la tradition anglo-saxonne, danslaquelle se manifeste toujours une méfiance envers l’autorité, surtout d’un pouvoir ou d’un Etat central, qui menacetoujours potentiellement notre liberté, et dont il faut limiter les prérogatives.
La Magna Carta de 1215 en Angleterre,garantit notamment aux sujets qu’ils ne seront pas emprisonnés arbitrairement, sans jugement.
La Déclarationd’indépendance américaine de 1776 est un cri de protestation contre le pouvoir despotique de la couronnebritannique.
Et aux Antilles, jusqu’à aujourd’hui, la liberté politique ne peut se concevoir, quel que soit le point devue que l’on adopte à ce sujet, sans faire référence au pouvoir colonial et à ce qu’il en reste, concrètement ou dansles mentalités.
On est donc tenté de concevoir, politiquement, la liberté comme le fait de faire tout ce que l’onveut.Il serait néanmoins trompeur de réduire la liberté politique à l’indépendance et de faire de l’obéissance à la loi unobstacle à la liberté en toutes circonstances.
Il suffit d’imaginer ce que serait un monde sans loi pour s’en rendrecompte : si chacun a la possibilité d’agir comme bon lui semble, sans se soucier d’autrui, alors il est toujours àcraindre d’être réduit en esclavage, d’être privé de sa liberté.
Il faut au moins opposer cette limite à la liberté : jene dois pas avoir la liberté de supprimer celle des autres, sinon la liberté devient contradictoire et peut se supprimerelle-même.
Il semble donc qu’une liberté comme indépendance absolue et comme pure affirmation de la volontéreste théorique et abstraite, tant son application pratique serait problématique (en plus d’être néfaste).
Il convientdès lors à présent de nous demander en quoi la loi, puis, comme nous le verrons, la raison, est une condition et nonun obstacle à la liberté, que l’on ne peut plus réduire à la seule expression de la volonté de l’homme.
Il nous faut dès lors définir la liberté, non plus comme indépendance, mais comme autonomie, ce qui signifiel’obéissance à une loi que l’on s’est fixé à soi-même.
Ce terme d’autonomie tire son origine de la Grèce antique, où ildésignait la liberté des citoyens d’Athènes, première forme de démocratie.
Le citoyen est dit autonome, non pasparce qu’il n’obéit à aucune loi, mais au contraire parce qu’il participe, par le débat sur l’Agora et par le vote, à laprise de décision commune, et parce qu’il accepte, de son propre chef, de s’obliger à respecter les lois qu’il acontribué à choisir.
La loi ne serait donc plus une contrainte, mais elle serait une obligation, notions distinctes car lacontrainte désigne la soumission à une force ou à un pouvoir qui nous vient de l’extérieur, et l’obligation le fait defaire une chose en en ayant soi-même, intérieurement pris la décision.
Pour les Athéniens, le fait de se soumettre àla loi n’est donc pas du tout une contrainte, ni une limite qui vient restreindre notre liberté, mais au contraire unacte par lequel nous affirmons notre liberté.Il peut évidemment arriver que les décisions ainsi prises ne nous semblent pas favorables.
Par exemple, l’Etat peutrelever le taux d’imposition d’une certaine partie de la population, qui se sent ainsi lésée, parfois de manière légitime.Mais cela ne signifie pas que nous serions plus libres dans un monde sans loi et sans Etat.
Dans le « Léviathan »,HOBBES montre que la liberté naturelle, celle dont nous jouissons à l’état de nature, est absolue, n’admet aucunelimite autre que physique.
Elle est conçue comme indépendance, comme le fait de faire tout ce que l’on veut, maisen réalité, elle est inapplicable, car nous aurions toujours à craindre pour nos biens, pour notre intégrité physique,ou pour notre vie.
Les hommes désirant les mêmes choses, et la nature est trop pauvre pour les satisfaire au mêmedegré, cela résulterait en une guerre de tous contre tous, à un état de guerre civile continuelle.
Et celui qui ensortirait, temporairement, vainqueur, pourrait toujours être renversé, même s’il est le plus fort et le plus rusé, parune coalition de forces.
Tout pouvoir serait ainsi instable.
C’est pour cette raison, selon HOBBES, que nous devonsrenoncer à l’usage privé de la force et la confier à l’Etat, seul dépositaire de la « violence légitime » (WEBER).
Nousne vivrons alors pas complètement sous la conduite de notre volonté, car il faudrait respecter les lois, mais nous nele ferions pas plus s’il n’y avait ni Etat ni loi : notre liberté, en théorie illimitée, serait dans les faits toujoursmenacée, ne s’appliquerait jamais vraiment.
La liberté politique semble donc de plus grande valeur que la liberténaturelle, et être libre n’est pas, à proprement parler, faire tout ce que l’on veut.Rousseau, dans «Le contrat social », envisage quant à lui le cas où le respect des lois nous paraitrait contraire ànotre volonté, nous léserait spécifiquement par rapport à d’autres.
Pour Rousseau, même dans ce cas, nous sommesplus libres en nous soumettant à la loi qu’en nous y dérobant.
Car la loi est pour Rousseau l’expression de la volontégénéral, non de la somme des volontés particulières, mais celle de la société prise comme une seule entité, commeun seul corps.
Refuser de respecter les lois au nom de sa volonté ne nous rend donc pas libres, au contraire, celanous rend étranger à la liberté et même à notre propre intérêt ; si je respecte une loi qui m’est défavorable, j’ensubis certes les désagréments, mais je n’en suis pas moins libre car je me soumets à la volonté générale, j’acceptemon appartenance à la communauté, qui seule me rend la vie possible.
La loi peut donc être contraire à ce que je.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- etre libre est ce faire ce que lon veut
- Sujet : Etre libre, est-ce faire ce que l’on veut ?
- Etre libre : Est-ce faire ce que l'on veut ?
- Etre libre, est-ce faire ce que l'on veut ?
- Etre libre, est-ce pouvoir faire ce que l'on veut ?