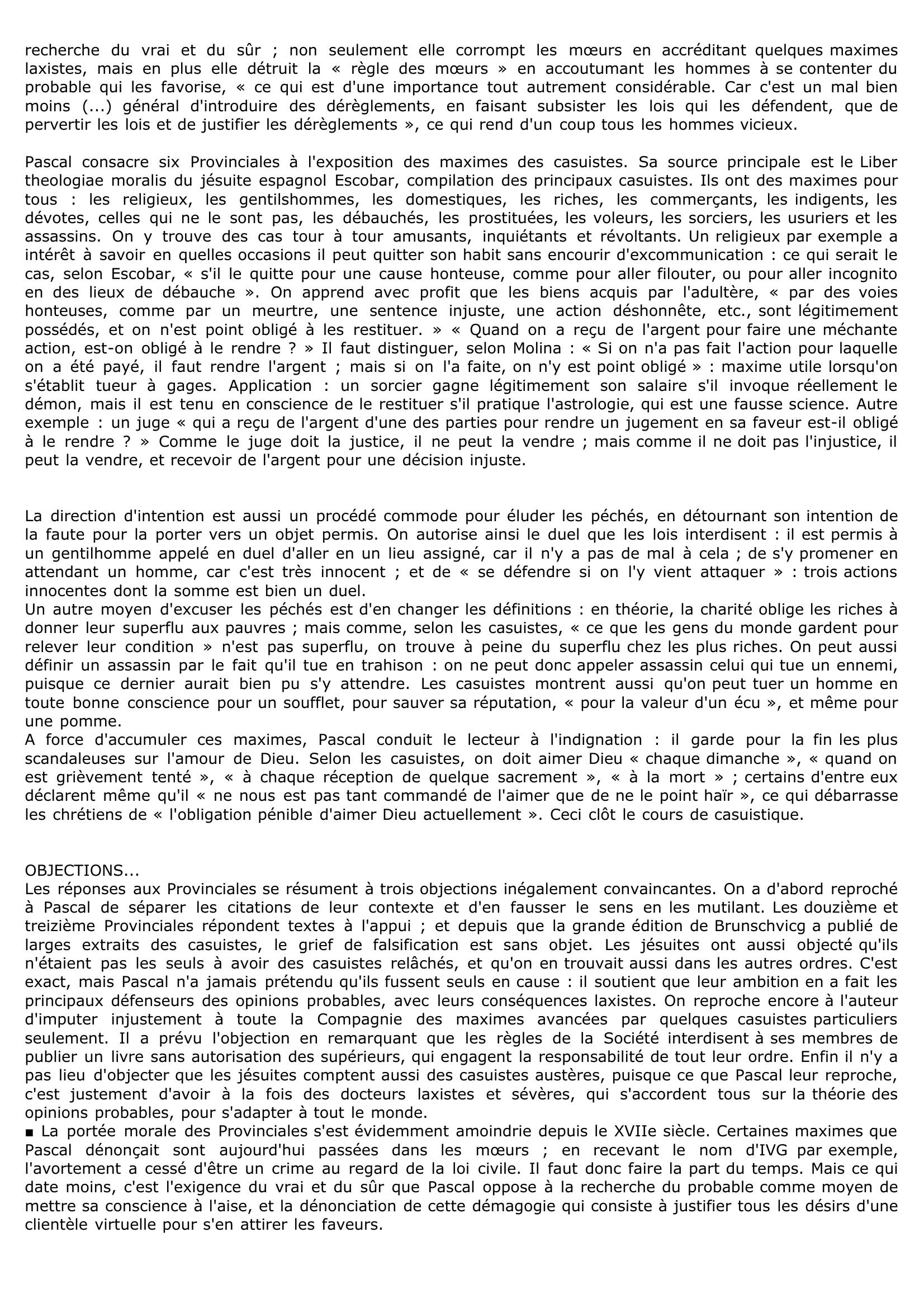PASCAL, LES JESUITES ET LA CASUISTIQUE DANS LES PROVINCIALES
Publié le 12/07/2011

Extrait du document

LETTRES I À IV (le problème de la grâce). On discute sur les questions de « pouvoir prochain « et de « grâce suffisante «. C'est que l'on s'entend mal sur le sens des termes. Si l'on va au fond des choses, on est forcé d'admettre que la grâce théoriquement suffisante ne peut devenir « efficace «, sans une intervention divine. Prétendre le contraire reviendrait à soutenir cette hérésie que l'homme peut faire son salut lui-même, sans l'aide de la grâce (I-II). — Il est impossible de condamner Arnauld sans condamner du même coup saint Augustin et saint Jean Chrysostome, dont il reprend les arguments (III).

«
recherche du vrai et du sûr ; non seulement elle corrompt les mœurs en accréditant quelques maximes
laxistes, mais en plus elle détruit la « règle des mœurs » en accoutumant les hommes à se contenter du
probable qui les favorise, « ce qui est d'une importance tout autrement considérable.
Car c'est un mal bien
moins (...) général d'introduire des dérèglements, en faisant subsister les lois qui les défendent, que de
pervertir les lois et de justifier les dérèglements », ce qui rend d'un coup tous les hommes vicieux.
Pascal consacre six Provinciales à l'exposition des maximes des casuistes.
Sa source principale est le Liber
theologiae moralis du jésuite espagnol Escobar, compilation des principaux casuistes.
Ils ont des maximes pour
tous : les religieux, les gentilshommes, les domestiques, les riches, les commerçants, les indigents, les
dévotes, celles qui ne le sont pas, les débauchés, les prostituées, les voleurs, les sorciers, les usuriers et les
assassins.
On y trouve des cas tour à tour amusants, inquiétants et révoltants.
Un religieux par exemple a
intérêt à savoir en quelles occasions il peut quitter son habit sans encourir d'excommunication : ce qui serait le
cas, selon Escobar, « s'il le quitte pour une cause honteuse, comme pour aller filouter, ou pour aller incognito
en des lieux de débauche ».
On apprend avec profit que les biens acquis par l'adultère, « par des voies
honteuses, comme par un meurtre, une sentence injuste, une action déshonnête, etc., sont légitimement
possédés, et on n'est point obligé à les restituer.
» « Quand on a reçu de l'argent pour faire une méchante
action, est-on obligé à le rendre ? » Il faut distinguer, selon Molina : « Si on n'a pas fait l'action pour laquelle
on a été payé, il faut rendre l'argent ; mais si on l'a faite, on n'y est point obligé » : maxime utile lorsqu'on
s'établit tueur à gages.
Application : un sorcier gagne légitimement son salaire s'il invoque réellement le
démon, mais il est tenu en conscience de le restituer s'il pratique l'astrologie, qui est une fausse science.
Autre
exemple : un juge « qui a reçu de l'argent d'une des parties pour rendre un jugement en sa faveur est-il obligé
à le rendre ? » Comme le juge doit la justice, il ne peut la vendre ; mais comme il ne doit pas l'injustice, il
peut la vendre, et recevoir de l'argent pour une décision injuste.
La direction d'intention est aussi un procédé commode pour éluder les péchés, en détournant son intention de
la faute pour la porter vers un objet permis.
On autorise ainsi le duel que les lois interdisent : il est permis à
un gentilhomme appelé en duel d'aller en un lieu assigné, car il n'y a pas de mal à cela ; de s'y promener en
attendant un homme, car c'est très innocent ; et de « se défendre si on l'y vient attaquer » : trois actions
innocentes dont la somme est bien un duel.
Un autre moyen d'excuser les péchés est d'en changer les définitions : en théorie, la charité oblige les riches à
donner leur superflu aux pauvres ; mais comme, selon les casuistes, « ce que les gens du monde gardent pour
relever leur condition » n'est pas superflu, on trouve à peine du superflu chez les plus riches.
On peut aussi
définir un assassin par le fait qu'il tue en trahison : on ne peut donc appeler assassin celui qui tue un ennemi,
puisque ce dernier aurait bien pu s'y attendre.
Les casuistes montrent aussi qu'on peut tuer un homme en
toute bonne conscience pour un soufflet, pour sauver sa réputation, « pour la valeur d'un écu », et même pour
une pomme.
A force d'accumuler ces maximes, Pascal conduit le lecteur à l'indignation : il garde pour la fin les plus
scandaleuses sur l'amour de Dieu.
Selon les casuistes, on doit aimer Dieu « chaque dimanche », « quand on
est grièvement tenté », « à chaque réception de quelque sacrement », « à la mort » ; certains d'entre eux
déclarent même qu'il « ne nous est pas tant commandé de l'aimer que de ne le point haïr », ce qui débarrasse
les chrétiens de « l'obligation pénible d'aimer Dieu actuellement ».
Ceci clôt le cours de casuistique.
OBJECTIONS...
Les réponses aux Provinciales se résument à trois objections inégalement convaincantes.
On a d'abord reproché
à Pascal de séparer les citations de leur contexte et d'en fausser le sens en les mutilant.
Les douzième et
treizième Provinciales répondent textes à l'appui ; et depuis que la grande édition de Brunschvicg a publié de
larges extraits des casuistes, le grief de falsification est sans objet.
Les jésuites ont aussi objecté qu'ils
n'étaient pas les seuls à avoir des casuistes relâchés, et qu'on en trouvait aussi dans les autres ordres.
C'est
exact, mais Pascal n'a jamais prétendu qu'ils fussent seuls en cause : il soutient que leur ambition en a fait les
principaux défenseurs des opinions probables, avec leurs conséquences laxistes.
On reproche encore à l'auteur
d'imputer injustement à toute la Compagnie des maximes avancées par quelques casuistes particuliers
seulement.
Il a prévu l'objection en remarquant que les règles de la Société interdisent à ses membres de
publier un livre sans autorisation des supérieurs, qui engagent la responsabilité de tout leur ordre.
Enfin il n'y a
pas lieu d'objecter que les jésuites comptent aussi des casuistes austères, puisque ce que Pascal leur reproche,
c'est justement d'avoir à la fois des docteurs laxistes et sévères, qui s'accordent tous sur la théorie des
opinions probables, pour s'adapter à tout le monde.
■ La portée morale des Provinciales s'est évidemment amoindrie depuis le XVIIe siècle.
Certaines maximes que
Pascal dénonçait sont aujourd'hui passées dans les mœurs ; en recevant le nom d'IVG par exemple,
l'avortement a cessé d'être un crime au regard de la loi civile.
Il faut donc faire la part du temps.
Mais ce qui
date moins, c'est l'exigence du vrai et du sûr que Pascal oppose à la recherche du probable comme moyen de
mettre sa conscience à l'aise, et la dénonciation de cette démagogie qui consiste à justifier tous les désirs d'une
clientèle virtuelle pour s'en attirer les faveurs..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PROVINCIALES (les), de Biaise Pascal
- PROVINCIALES (les). Lettres polémiques de Blaise Pascal (résumé et analyse de l'oeuvre)
- Les Provinciales de Pascal (résumé & analyse)
- PROVINCIALES (LES) ou LETTRES ÉCRITES À UN PROVINCIAL PAR UN DE SES AMIS, SUR LE SUJET DES DISPUTES PRÉSENTES DE LA SORBONNE, Blaise Pascal
- PROVINCIALES (Les) de Blaise Pascal (résumé & analyse)