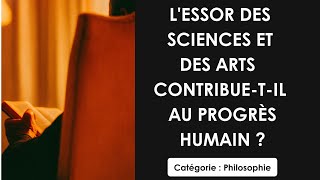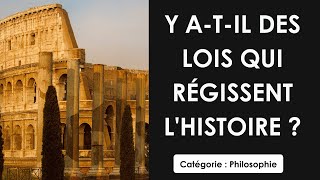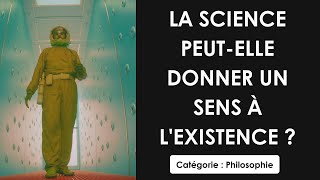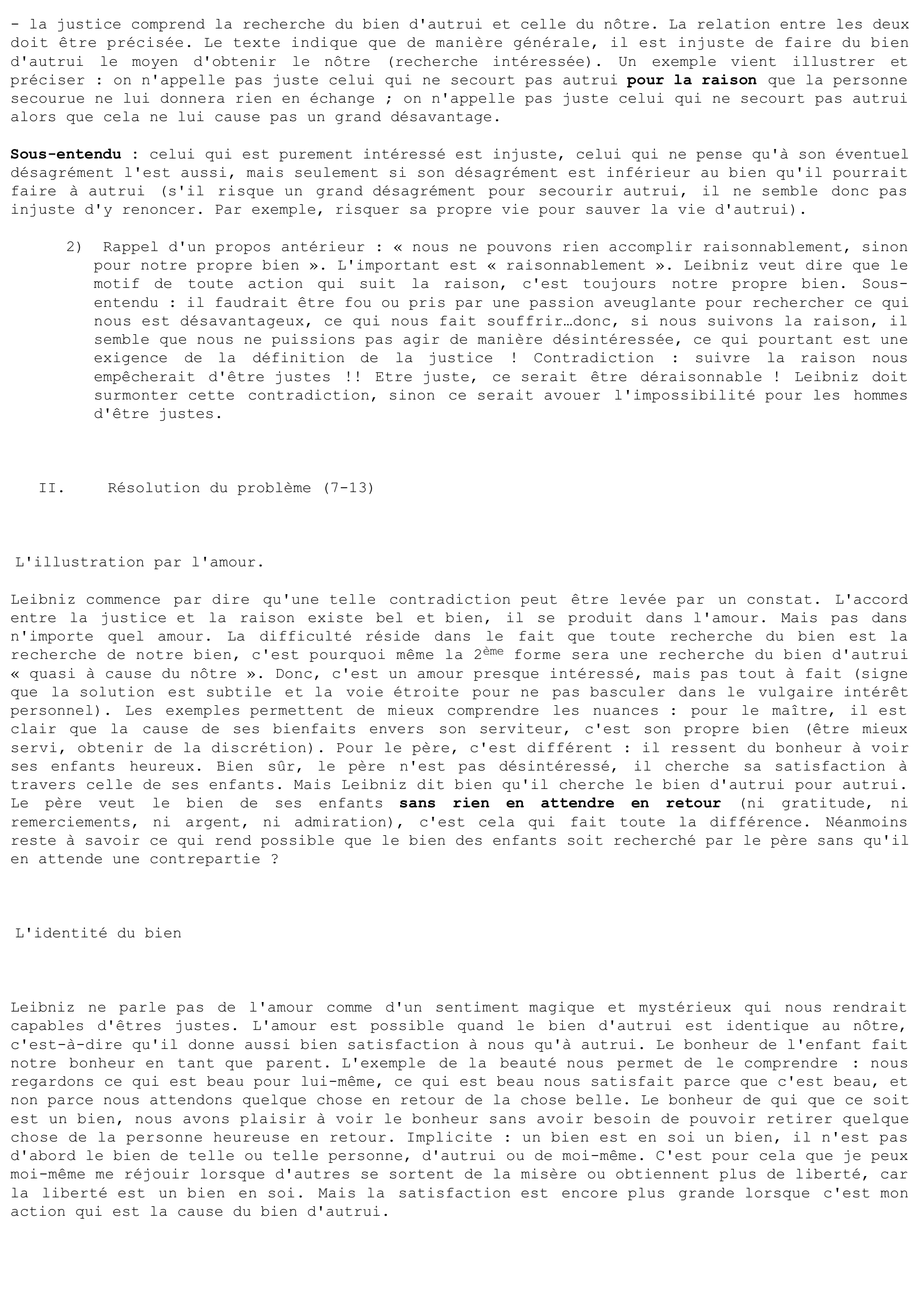Texte de Leibniz, extrait des « Eléments de droit naturel » (in Le Droit de la Raison)
Publié le 25/02/2011

Extrait du document
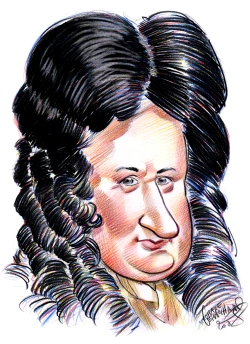
Extrait étudié : " Il y a dans la justice une considération du bien d'autrui, et aussi du nôtre, mais non cependant telle, que celui-ci soit la fin de l'autre, sinon il s'ensuivrait qu'on laisserait de droit un misérable aller à sa perte, alors que nous pouvons presque sans peine l'en arracher, quand il est certain que notre aide ne sera pas récompensée. Ce que tous exècrent comme criminel. Mais comment seront conciliées ces affirmations, quand nous disions plus haut que nous ne pouvons rien accomplir raisonnablement, sinon pour notre propre bien, puisque maintenant nous nions qu'il faille rechercher le bien d'autrui à cause du nôtre? Cela dépend de la nature de l'amour. Il y a deux raisons de désirer le bien d'autrui, la première à cause du nôtre, la seconde quasi à cause du nôtre, la première étant celle qui calcule, la seconde celle qui aime, la première est l'affection du maître envers son serviteur, la seconde celle du père envers ses enfants ; dans le premier cas, le bien d'autrui est recherché pour un autre bien, dans le second cas pour lui-même. Mais demandera-t-on, comment peut-il se faire, que le bien d'autrui soit identique au nôtre et cependant recherché pour lui-même? Moi j'affirme qu'il peut l'être lorsqu'il est agréable. Nous cherchons les belles choses parce qu'elles sont agréables. Mais l'agrément est doublé par notre réflexion toutes les fois que nous contemplons notre beauté, ce qui a lieu par la conscience silencieuse de notre vertu. De même que dans la vision peut se produire une double réfraction, l'une dans la lentille de l'oeil, l'autre dans la lentille de la lunette, dont la seconde augmente la première, ainsi dans la pensée la réflexion est double. En effet, puisque tout esprit est une sorte de miroir, l'un sera dans notre esprit, l'autre dans celui d'autrui, et s'il y a plusieurs miroirs, c'est-à-dire plusieurs esprits reconnaissant nos biens, la lumière sera plus grande : les miroirs concentrant la lumière non seulement dans l'oeil mais aussi entre eux. "
Introduction : Lorsque nous pensons à la justice, il nous vient assez vite à l’esprit que le droit est l’instrument par lequel les hommes instaurent plus de justice dans leur monde. Mais celle-ci ne dépendrait-elle pas aussi de la conduite de chacun d’entre nous ? S’il est vain d’attendre que tout un chacun se conduise justement (et c’est peut-être pour cela que le droit est indispensable), il n’est pas inutile de se pencher sur cette vertu humaine que peut être la justice. Comment doit se comporter un homme juste ? Est-il seulement possible d’être juste, tant les exigences qui sont celles de la justice semblent élevées, voire impossibles à satisfaire ?
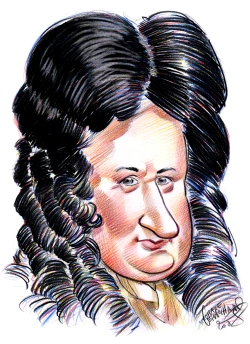
«
- la justice comprend la recherche du bien d'autrui et celle du nôtre.
La relation entre les deuxdoit être précisée.
Le texte indique que de manière générale, il est injuste de faire du biend'autrui le moyen d'obtenir le nôtre (recherche intéressée).
Un exemple vient illustrer etpréciser : on n'appelle pas juste celui qui ne secourt pas autrui pour la raison que la personne secourue ne lui donnera rien en échange ; on n'appelle pas juste celui qui ne secourt pas autruialors que cela ne lui cause pas un grand désavantage.
Sous-entendu : celui qui est purement intéressé est injuste, celui qui ne pense qu'à son éventuel désagrément l'est aussi, mais seulement si son désagrément est inférieur au bien qu'il pourraitfaire à autrui (s'il risque un grand désagrément pour secourir autrui, il ne semble donc pasinjuste d'y renoncer.
Par exemple, risquer sa propre vie pour sauver la vie d'autrui).
2) Rappel d'un propos antérieur : « nous ne pouvons rien accomplir raisonnablement, sinonpour notre propre bien ».
L'important est « raisonnablement ».
Leibniz veut dire que lemotif de toute action qui suit la raison, c'est toujours notre propre bien.
Sous-entendu : il faudrait être fou ou pris par une passion aveuglante pour rechercher ce quinous est désavantageux, ce qui nous fait souffrir…donc, si nous suivons la raison, ilsemble que nous ne puissions pas agir de manière désintéressée, ce qui pourtant est uneexigence de la définition de la justice ! Contradiction : suivre la raison nousempêcherait d'être justes !! Etre juste, ce serait être déraisonnable ! Leibniz doitsurmonter cette contradiction, sinon ce serait avouer l'impossibilité pour les hommesd'être justes.
II. Résolution du problème (7-13)
1) L'illustration par l'amour.
Leibniz commence par dire qu'une telle contradiction peut être levée par un constat.
L'accordentre la justice et la raison existe bel et bien, il se produit dans l'amour.
Mais pas dansn'importe quel amour.
La difficulté réside dans le fait que toute recherche du bien est larecherche de notre bien, c'est pourquoi même la 2 ème forme sera une recherche du bien d'autrui « quasi à cause du nôtre ».
Donc, c'est un amour presque intéressé, mais pas tout à fait (signeque la solution est subtile et la voie étroite pour ne pas basculer dans le vulgaire intérêtpersonnel).
Les exemples permettent de mieux comprendre les nuances : pour le maître, il estclair que la cause de ses bienfaits envers son serviteur, c'est son propre bien (être mieuxservi, obtenir de la discrétion).
Pour le père, c'est différent : il ressent du bonheur à voirses enfants heureux.
Bien sûr, le père n'est pas désintéressé, il cherche sa satisfaction àtravers celle de ses enfants.
Mais Leibniz dit bien qu'il cherche le bien d'autrui pour autrui.Le père veut le bien de ses enfants sans rien en attendre en retour (ni gratitude, ni remerciements, ni argent, ni admiration), c'est cela qui fait toute la différence.
Néanmoinsreste à savoir ce qui rend possible que le bien des enfants soit recherché par le père sans qu'ilen attende une contrepartie ?
2) L'identité du bien
Leibniz ne parle pas de l'amour comme d'un sentiment magique et mystérieux qui nous rendraitcapables d'êtres justes.
L'amour est possible quand le bien d'autrui est identique au nôtre,c'est-à-dire qu'il donne aussi bien satisfaction à nous qu'à autrui.
Le bonheur de l'enfant faitnotre bonheur en tant que parent.
L'exemple de la beauté nous permet de le comprendre : nousregardons ce qui est beau pour lui-même, ce qui est beau nous satisfait parce que c'est beau, etnon parce nous attendons quelque chose en retour de la chose belle.
Le bonheur de qui que ce soitest un bien, nous avons plaisir à voir le bonheur sans avoir besoin de pouvoir retirer quelquechose de la personne heureuse en retour.
Implicite : un bien est en soi un bien, il n'est pasd'abord le bien de telle ou telle personne, d'autrui ou de moi-même.
C'est pour cela que je peuxmoi-même me réjouir lorsque d'autres se sortent de la misère ou obtiennent plus de liberté, carla liberté est un bien en soi.
Mais la satisfaction est encore plus grande lorsque c'est monaction qui est la cause du bien d'autrui..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire Du Texte De Jean-Pierre Duprat, Extrait De « Le Monstre Acéphale » Dans La Constitution Du 24 Juin 1793 : L'utopie Dans Le Droit Public Français
- Explication de texte – Leibniz extrait « préface aux nouveaux essais de l'entendement humain ». Extrait étudié : « Les sens quoi que nécessaires [ …] jamais avisé d'y penser. »
- Commentaire de texte de M. Villey, extrait de son ouvrage « Le droit et les droits de l'homme »
- Vous commenterez le texte suivant en éclairant vos réflexions de références aux œuvres des « philosophes » que vous connaissez : « A une civilisation fondée sur l'idée de devoir, les devoirs envers Dieu, les devoirs envers le prince, les « nouveaux philosophes » ont essayé de substituer une civilisation fondée sur l'idée de droit : les droits de la conscience individuelle, les droits de la critique, les droits de la raison, les droits de l'homme et du citoyen. » (P. Hazard, La Crise de
- Commentez cette définition des «lumières» par Kant (article «Qu'est-ce que les Lumières ?») : «Qu'est-ce que les Lumières ? La sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui, minorité dont il est lui-même responsable puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere