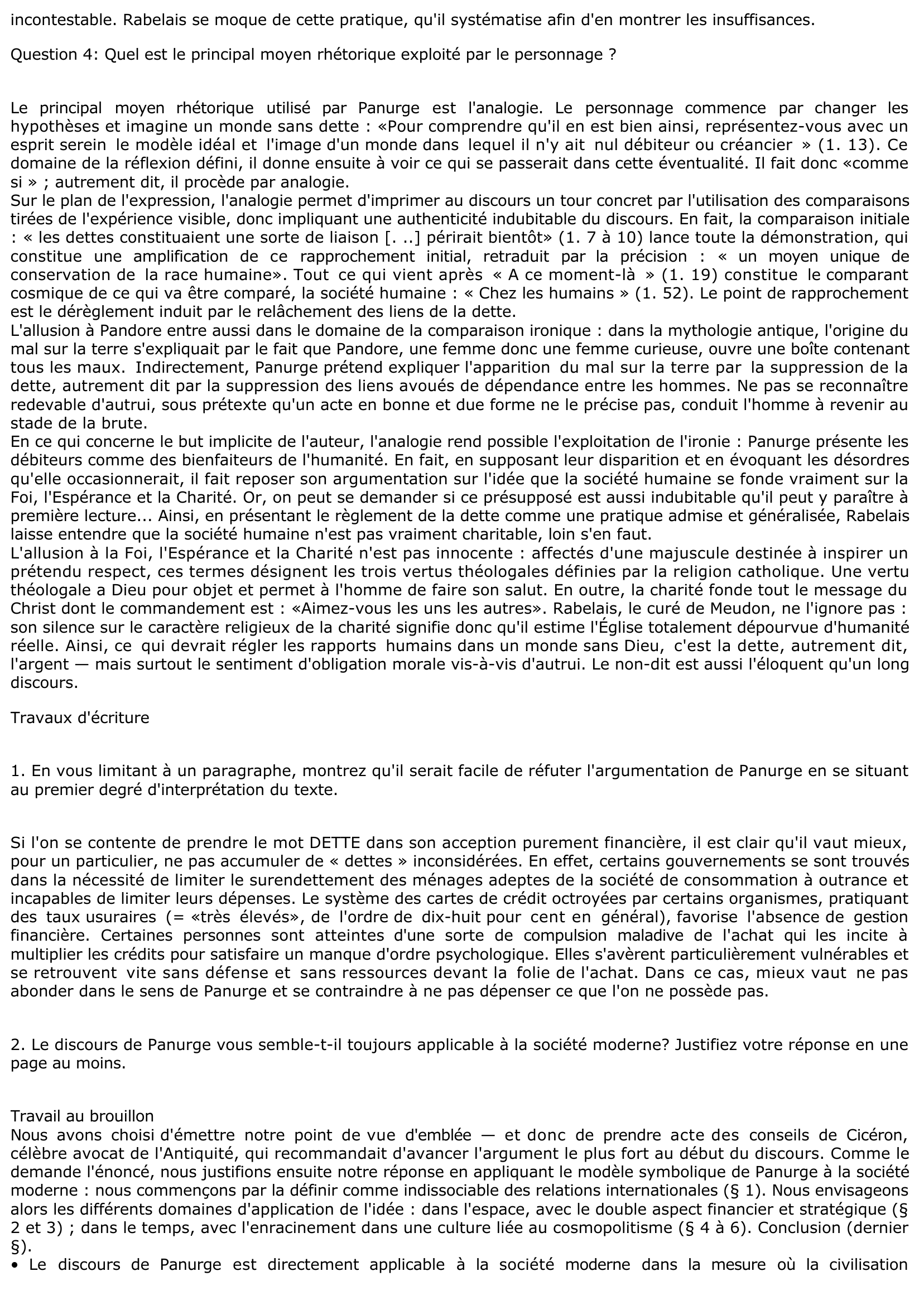Rabelais, Tiers Livre: "Cependant, n'est pas débiteur qui veut; ne se fait pas de créanciers qui le veut... cette truandaille de monde qui ne prête rien. Par ma foi, je les hais bien !".
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
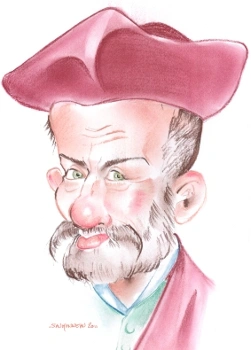
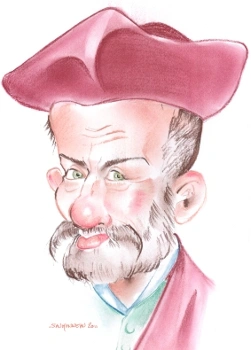
«
incontestable.
Rabelais se moque de cette pratique, qu'il systématise afin d'en montrer les insuffisances.
Question 4: Quel est le principal moyen rhétorique exploité par le personnage ?
Le principal moyen rhétorique utilisé par Panurge est l'analogie.
Le personnage commence par changer leshypothèses et imagine un monde sans dette : «Pour comprendre qu'il en est bien ainsi, représentez-vous avec unesprit serein le modèle idéal et l'image d'un monde dans lequel il n'y ait nul débiteur ou créancier » (1.
13).
Cedomaine de la réflexion défini, il donne ensuite à voir ce qui se passerait dans cette éventualité.
Il fait donc «commesi » ; autrement dit, il procède par analogie.Sur le plan de l'expression, l'analogie permet d'imprimer au discours un tour concret par l'utilisation des comparaisonstirées de l'expérience visible, donc impliquant une authenticité indubitable du discours.
En fait, la comparaison initiale: « les dettes constituaient une sorte de liaison [.
..] périrait bientôt» (1.
7 à 10) lance toute la démonstration, quiconstitue une amplification de ce rapprochement initial, retraduit par la précision : « un moyen unique deconservation de la race humaine».
Tout ce qui vient après « A ce moment-là » (1.
19) constitue le comparantcosmique de ce qui va être comparé, la société humaine : « Chez les humains » (1.
52).
Le point de rapprochementest le dérèglement induit par le relâchement des liens de la dette.L'allusion à Pandore entre aussi dans le domaine de la comparaison ironique : dans la mythologie antique, l'origine dumal sur la terre s'expliquait par le fait que Pandore, une femme donc une femme curieuse, ouvre une boîte contenanttous les maux.
Indirectement, Panurge prétend expliquer l'apparition du mal sur la terre par la suppression de ladette, autrement dit par la suppression des liens avoués de dépendance entre les hommes.
Ne pas se reconnaîtreredevable d'autrui, sous prétexte qu'un acte en bonne et due forme ne le précise pas, conduit l'homme à revenir austade de la brute.En ce qui concerne le but implicite de l'auteur, l'analogie rend possible l'exploitation de l'ironie : Panurge présente lesdébiteurs comme des bienfaiteurs de l'humanité.
En fait, en supposant leur disparition et en évoquant les désordresqu'elle occasionnerait, il fait reposer son argumentation sur l'idée que la société humaine se fonde vraiment sur laFoi, l'Espérance et la Charité.
Or, on peut se demander si ce présupposé est aussi indubitable qu'il peut y paraître àpremière lecture...
Ainsi, en présentant le règlement de la dette comme une pratique admise et généralisée, Rabelaislaisse entendre que la société humaine n'est pas vraiment charitable, loin s'en faut.L'allusion à la Foi, l'Espérance et la Charité n'est pas innocente : affectés d'une majuscule destinée à inspirer unprétendu respect, ces termes désignent les trois vertus théologales définies par la religion catholique.
Une vertuthéologale a Dieu pour objet et permet à l'homme de faire son salut.
En outre, la charité fonde tout le message duChrist dont le commandement est : «Aimez-vous les uns les autres».
Rabelais, le curé de Meudon, ne l'ignore pas :son silence sur le caractère religieux de la charité signifie donc qu'il estime l'Église totalement dépourvue d'humanitéréelle.
Ainsi, ce qui devrait régler les rapports humains dans un monde sans Dieu, c'est la dette, autrement dit,l'argent — mais surtout le sentiment d'obligation morale vis-à-vis d'autrui.
Le non-dit est aussi l'éloquent qu'un longdiscours.
Travaux d'écriture
1.
En vous limitant à un paragraphe, montrez qu'il serait facile de réfuter l'argumentation de Panurge en se situantau premier degré d'interprétation du texte.
Si l'on se contente de prendre le mot DETTE dans son acception purement financière, il est clair qu'il vaut mieux,pour un particulier, ne pas accumuler de « dettes » inconsidérées.
En effet, certains gouvernements se sont trouvésdans la nécessité de limiter le surendettement des ménages adeptes de la société de consommation à outrance etincapables de limiter leurs dépenses.
Le système des cartes de crédit octroyées par certains organismes, pratiquantdes taux usuraires (= «très élevés», de l'ordre de dix-huit pour cent en général), favorise l'absence de gestionfinancière.
Certaines personnes sont atteintes d'une sorte de compulsion maladive de l'achat qui les incite àmultiplier les crédits pour satisfaire un manque d'ordre psychologique.
Elles s'avèrent particulièrement vulnérables etse retrouvent vite sans défense et sans ressources devant la folie de l'achat.
Dans ce cas, mieux vaut ne pasabonder dans le sens de Panurge et se contraindre à ne pas dépenser ce que l'on ne possède pas.
2.
Le discours de Panurge vous semble-t-il toujours applicable à la société moderne? Justifiez votre réponse en unepage au moins.
Travail au brouillonNous avons choisi d'émettre notre point de vue d'emblée — et donc de prendre acte des conseils de Cicéron,célèbre avocat de l'Antiquité, qui recommandait d'avancer l'argument le plus fort au début du discours.
Comme ledemande l'énoncé, nous justifions ensuite notre réponse en appliquant le modèle symbolique de Panurge à la sociétémoderne : nous commençons par la définir comme indissociable des relations internationales (§ 1).
Nous envisageonsalors les différents domaines d'application de l'idée : dans l'espace, avec le double aspect financier et stratégique (§2 et 3) ; dans le temps, avec l'enracinement dans une culture liée au cosmopolitisme (§ 4 à 6).
Conclusion (dernier§).• Le discours de Panurge est directement applicable à la société moderne dans la mesure où la civilisation.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TIERS LIVRE des faits et dits héroïques du bon Pantagruel. Récit de François Rabelais (résumé & analyse)
- Tiers Livre de Rabelais
- TIERS LIVRE DES FAICTS ET DICTS HEROÏQUES DU NOBLE PANTAGRUEL de François Rabelais (résumé)
- Le Tiers livre, le quart Livre et le cinquième Livre de RABELAIS
- Séquence I L’humanisme. Texte 1 : Rabelais, Tiers Livre, chapitre 51, « L’éloge du Pantagruélion ».